mercredi 30 mai 2007
De la naïveté en matière d'échanges internationaux
Par xerbias, mercredi 30 mai 2007 à 23:29 :: Monde
 Danone a eu une nouvelle mauvaise surprise en Chine. Les organismes de contrôles chinois disent y avoir trouvé un taux anormalement élevé de bactéries, donnant l'impression aux consommateurs qu'elle pourrait être dangereuse, et entrainant donc un boycott de fait. Cela fait suite aux multiples conflits qu'a le groupe français avec son partenaire chinois Wahaha, qui oublie ses accords pour mieux doubler la multinationale. Le patriotisme économique chinois n'est plus à prouver, et un exemple nous en est ici donné. D'une manière générale, l'obligation pour les multinationales de faire des joint-ventures avec les entreprises locales pour pouvoir s'y développer est l'occasion de créer une alliance tout à fait disproportionnée, dans la mesure où seul le groupe chinois est appelé à en profiter. Si l'entreprise occidentale vient à prendre trop d'importance, les ennuis commencent. Dans un pays où la bureaucratie forme un système politique, les autorisations de faire quoi que ce soit deviennent tout d'un coup très compliquées à obtenir. Le but est évidemment que la partie chinoise prenne l'ascendant sur le contrôle du marché intérieur. Elle pourra éventuellement se développer à l'étranger en bénéficiant de ce marché garanti, et des transferts de savoir faire réalisés pendant le partenariat. En fin de compte, la Chine joue tout simplement ses propres intérêts, en facilitant tout en cynisme le développement des ses propres champions nationaux. En laissant faire cela, les autres pays développés se jette allègrement dans une naïveté touchante.
Danone a eu une nouvelle mauvaise surprise en Chine. Les organismes de contrôles chinois disent y avoir trouvé un taux anormalement élevé de bactéries, donnant l'impression aux consommateurs qu'elle pourrait être dangereuse, et entrainant donc un boycott de fait. Cela fait suite aux multiples conflits qu'a le groupe français avec son partenaire chinois Wahaha, qui oublie ses accords pour mieux doubler la multinationale. Le patriotisme économique chinois n'est plus à prouver, et un exemple nous en est ici donné. D'une manière générale, l'obligation pour les multinationales de faire des joint-ventures avec les entreprises locales pour pouvoir s'y développer est l'occasion de créer une alliance tout à fait disproportionnée, dans la mesure où seul le groupe chinois est appelé à en profiter. Si l'entreprise occidentale vient à prendre trop d'importance, les ennuis commencent. Dans un pays où la bureaucratie forme un système politique, les autorisations de faire quoi que ce soit deviennent tout d'un coup très compliquées à obtenir. Le but est évidemment que la partie chinoise prenne l'ascendant sur le contrôle du marché intérieur. Elle pourra éventuellement se développer à l'étranger en bénéficiant de ce marché garanti, et des transferts de savoir faire réalisés pendant le partenariat. En fin de compte, la Chine joue tout simplement ses propres intérêts, en facilitant tout en cynisme le développement des ses propres champions nationaux. En laissant faire cela, les autres pays développés se jette allègrement dans une naïveté touchante.C'est surtout le trait de caractère de l'Union Européenne à vrai dire. Elle aussi peut être considérée comme ayant une certaine forme de bureaucratie, mais celle-ci est bien moins dédiée à la défense des intérêts communautaires qu'à la concrétisation de doctrines parfois déconnectées de la réalité. C'est le cas dans le domaine des échanges commerciaux. Le but même de l'OMC est de favoriser les échanges entre pays, appelant à toujours lever davantage les obstacles au commerce international. Cette ouverture forcenée devient un but en soi, sa raison de vivre. Et à l'instar du Commissaire à l'élargissement qui veut faire adhérer à tous prix des pays à l'Union Européenne, car c'est sa raison d'être, le Commissaire au commerce, Peter Mandelson, semble si désespéré d'obtenir des accords qu'il est prêt à d'énormes concessions, sortant de loin de son mandat, pour ne pas que l'Europe soit accusée de bloquer le cycle de négociations de Doha à l'OMC. Dans ces discussions, il n'est plus vraiment question de réciprocité, seulement de concessions que l'Union Européenne aurait à faire de façon unilatérale sur l'agriculture. Ce faisant, l'Union Européenne ne peut qu'agrandir le fossé qui l'éloigne de ses citoyens. Elle ne comprend pas qu'il fasse avant tout défendre les intérêts de ceux-ci plutôt que la gloire d'un dogme. Etant une zone de libre échange à l'origine, l'Union Européenne est évidemment imprégnée de libre-échangisme. Si celui-ci est souhaitable, il ne doit pas être une telle priorité que l'Europe en devienne le dindon de la farce vis-à-vis d'autres pays qui eux comprennent bien où sont leurs intérêts.
Lorsque de telles positions ont été exprimées pendant la campagne présidentielle, elles furent accusées de "pop internationalism". Il s'agit du titre original d'un livre de l'économiste Paul Krugman, connu en France sous le titre "La mondialisation n'est pas coupable". Il y ait fait une défense acharnée de la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, accusant ceux qui s'en prennent à la mondialisation de méconnaître cette base de l'économie. Or elle est pour moins difficile, voire illusoire à mettre en oeuvre. En l'occurrence, il s'agirait pour l'Europe de sacrifier son agriculture et son industrie, pour mieux se concentrer sur les services. Mais qui peut croire que les pays dont l'agriculture et l'industrie ont le vent en poupe vont oublier de se développer dans les services ? Il ne s'agit en fait que de créer une incroyabale dépendance vis-à-vis de pays tiers. L'Inde est d'ores et déjà puissante dans des domaines technologiquement évolués, comme l'informatique, et la Chine table sur une stratégie ne délaissant aucun secteur. En outre, pour ceux qui travaillent dans les secteurs "à oublier" en Europe, la transition peut être particulièrement difficile.
S'il ne s'agit pas de faire du protectionnisme pour autant, au moins l'Europe devrait elle prendre conscience du danger qu'il y a de rester trop naïf en la matière. Elle aussi ne devrait pas hésiter à défendre ses intérêts le plus possible. Après tout, une de ses raisons d'exister est d'avoir une taille et une puissance suffisante pour faire poids au niveau mondial. Il faut en profiter, pour que ses citoyens en profitent à leur tour. Quitte à délaisser pour cela les utopies théoriques qui la minent en matière économique.
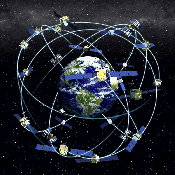 Depuis des années, le dossier Galileo est géré avec attention par la Commission européenne. Il s'agit d'un projet de système de positionnement par satellite semblable et concurrent au GPS, opéré par les Etats-Unis. Ainsi, après le projet pan-européen Airbus, Galileo est une nouvelle occasion de faire progresser la haute technologie européenne via une une nouvelle industrie qui n'est accessible qu'aux pays de grande envergure : les investissements à réaliser sont colossaux, et les infrastructures doivent être solides. Pourtant, si Galileo avait beaucoup d'espoir placé en son avenir, il enchaîne les difficultés avant même que sa naissance soit effective. En premier lieu, le projet hérite de tous les conflits dont a coutume l'Europe, c'est-à-dire des affrontements de pouvoir, pour savoir où tel et tel bases seront installées. Plusieurs pays se disputent le bénéfice des investissements, conditionnent leur financement à l'attribution de prérogatives dans une grande tradition où l'Europe doit servir les intérêts particuliers et immédiats de chaque pays. Ensuite, la Commission européenne doit faire face à des difficultés d'ordre industrielles : les différents groupes qui peuvent mettre au point la technologie et la construire se perdent en luttes entre concurrents plutôt que de coopérer, et refusent de prendre le moindre risque, notamment en terme de financement, alors qu'ils en seraient les bénéficiaires les plus immédiats. En conséquence, le Commissaire aux transports, Jacques Barrot, est obligé de faire appel aux contribuables européens pour financer le projet, en utilisant les crédits du budget européen qui est pourtant bien limité, voire en faisant appel davantage à des financements venant d'Etats membres. Enfin, la Commission européenne ne dispose pas d'expertise directe sur ce dossier qu'elle opère pourtant. Logiquement, il serait plus pertinent qu'il soit placé directement entre les mains de l'Agence Spatiale Européenne pour ce qui concerne la mise en œuvre. Or celle-ci n'est pas une filiation de l'Union Européenne (qui est ici à l'initiative), et ne rassemble d'ailleurs pas exactement les même membres.
Depuis des années, le dossier Galileo est géré avec attention par la Commission européenne. Il s'agit d'un projet de système de positionnement par satellite semblable et concurrent au GPS, opéré par les Etats-Unis. Ainsi, après le projet pan-européen Airbus, Galileo est une nouvelle occasion de faire progresser la haute technologie européenne via une une nouvelle industrie qui n'est accessible qu'aux pays de grande envergure : les investissements à réaliser sont colossaux, et les infrastructures doivent être solides. Pourtant, si Galileo avait beaucoup d'espoir placé en son avenir, il enchaîne les difficultés avant même que sa naissance soit effective. En premier lieu, le projet hérite de tous les conflits dont a coutume l'Europe, c'est-à-dire des affrontements de pouvoir, pour savoir où tel et tel bases seront installées. Plusieurs pays se disputent le bénéfice des investissements, conditionnent leur financement à l'attribution de prérogatives dans une grande tradition où l'Europe doit servir les intérêts particuliers et immédiats de chaque pays. Ensuite, la Commission européenne doit faire face à des difficultés d'ordre industrielles : les différents groupes qui peuvent mettre au point la technologie et la construire se perdent en luttes entre concurrents plutôt que de coopérer, et refusent de prendre le moindre risque, notamment en terme de financement, alors qu'ils en seraient les bénéficiaires les plus immédiats. En conséquence, le Commissaire aux transports, Jacques Barrot, est obligé de faire appel aux contribuables européens pour financer le projet, en utilisant les crédits du budget européen qui est pourtant bien limité, voire en faisant appel davantage à des financements venant d'Etats membres. Enfin, la Commission européenne ne dispose pas d'expertise directe sur ce dossier qu'elle opère pourtant. Logiquement, il serait plus pertinent qu'il soit placé directement entre les mains de l'Agence Spatiale Européenne pour ce qui concerne la mise en œuvre. Or celle-ci n'est pas une filiation de l'Union Européenne (qui est ici à l'initiative), et ne rassemble d'ailleurs pas exactement les même membres.  En France nous venons de sortir d'une élection présidentielle marquée par un clivage politique fort. La Turquie aussi est sur le point d'élire un nouveau président, et là-bas aussi le clivage politique est très marqué. Seulement, il ne s'opère entre la gauche et la droite traditionnelles comme en France ou dans la plupart des pays développés, mais entre les nationalistes et les islamistes. La Turquie est dans un système parlementaire, où le Président est élu de façon indirecte, par l'Assemblée. Le parti majoritaire (formé des islamistes de l'AKP) a essayé de faire élire Abdullah Gül, le ministre des Affaires étrangères en place. Les laïques de l'opposition s'y sont fortement opposés, y voyant un risque pour la nature laïque du régime turc. D'énormes manifestations se sont ainsi succédées, et l'armée, qui en Turquie est très forte et se considère comme garante de la pérennité du régime, a même ouvertement menacé d'intervenir. En fin de compte, les députés de l'opposition refusant de siéger pour le vote, l'élection n'a pu avoir lieu et Abdullah Gül a fini par se retirer. Mais Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre, ne renonce pas pour autant de voir une personnalité de son bord accéder à la Présidence, et souhaite modifier la Constitution pour que le scrutin soit direct, profitant ainsi de la force actuelle des islamistes dans le paysage politique turc actuel.
En France nous venons de sortir d'une élection présidentielle marquée par un clivage politique fort. La Turquie aussi est sur le point d'élire un nouveau président, et là-bas aussi le clivage politique est très marqué. Seulement, il ne s'opère entre la gauche et la droite traditionnelles comme en France ou dans la plupart des pays développés, mais entre les nationalistes et les islamistes. La Turquie est dans un système parlementaire, où le Président est élu de façon indirecte, par l'Assemblée. Le parti majoritaire (formé des islamistes de l'AKP) a essayé de faire élire Abdullah Gül, le ministre des Affaires étrangères en place. Les laïques de l'opposition s'y sont fortement opposés, y voyant un risque pour la nature laïque du régime turc. D'énormes manifestations se sont ainsi succédées, et l'armée, qui en Turquie est très forte et se considère comme garante de la pérennité du régime, a même ouvertement menacé d'intervenir. En fin de compte, les députés de l'opposition refusant de siéger pour le vote, l'élection n'a pu avoir lieu et Abdullah Gül a fini par se retirer. Mais Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre, ne renonce pas pour autant de voir une personnalité de son bord accéder à la Présidence, et souhaite modifier la Constitution pour que le scrutin soit direct, profitant ainsi de la force actuelle des islamistes dans le paysage politique turc actuel.