mercredi 31 mai 2006
Si vis pacem, para bellum
Par xerbias, mercredi 31 mai 2006 à 21:45 :: Monde
Dans son dernier livre, François Hollande évoque la diminution des crédits affectés à la défense nationale comme une possible piste pour dégager des marges budgétaires. Il reprend une ancienne idée de la gauche, qui se méfie de l'armée en la suspectant de favoriser la guerre. Pour un gouvernement qui recherche la paix et de l'argent, l'équation se résoudrait donc par une baisse des moyens financiers accordés aux armées. Le raisonnement s'appuierait notamment sur le fait que depuis la chute de l'URSS, il ne serait plus nécessaire de rester aussi sourcilleux sur notre défense, dans la mesure où la Russie ne serait plus un danger. Le raisonnement peut quand même paraître surprenant : s'il est vrai que les risques de conflits entre Etats ont diminué depuis la fin de la guerre froide, la situation géopolitique est loin de paraître apaisée de façon globale. Aux chocs symétriques, où deux armées s'opposent de façon frontale, suivent les affrontements asymétriques, où des armées font face à des guérillas diffuses, incapables d'affronter frontalement les grands pays, mais néanmoins aptes à les user considérablement. Il ne faut pas non plus négliger l'attitude de pays franchements hostiles à l'occident, qu'il serait irresponsable de négliger.
Si vis pacem, para bellum (Si tu veux la paix, prépares la guerre) est un ancien proverbe qu'il peut être bon de se rappeler constamment. Préparer la guerre, ça ne veut pas forcément dire la faire. Il convient surtout de rester toujours à l'affût, de ne pas se laisser aller à croire que tout est acquis. La stratégie de dissuasion nucléaire a permis d'éviter le conflit entre les Soviétiques et les occidentaux, ce modus vivendi a succédé à la stratégie réaliste d'équilibre des forces qui permit la paix au XIXème siècle, sous l'inspiration de Metternich. Là, il ne s'agit que d'avoir des armées prêtes à répondre à toute alerte, capables d'agir sans sourciller en cas de besoin. Et les occasions peuvent surgir à n'importe quel moment.
Le 11 septembre 2001, les Etats-Unis subirent une attaque terroriste considérée avec raison comme un acte de guerre. Les responsables de cette attaque étaient soutenus par un régime hostile, incarné par le gouvernement taliban de l'Afghanistan. A l'époque, la situation n'était pas difficile à juger, et rares sont ceux qui critiquent même aujourd'hui la décision d'anéantir le régime taliban. Les Etats-Unis et ses alliés se sont donc rapidement convenus sur l'attaque de l'Afghanistan, et leurs capacités militaires leur permirent d'intervenir rapidement. Ils purent donc se battre aux côtés des forces libres du Nord que dirigeait le commandant Massoud, et renverser ce gouvernement. Aujourd'hui encore, les alliés restent en poste en Afghanistan pour stabiliser le pays autour de son nouveau gouvernement élu de façon démocratique, et empêché le retour au pouvoir d'extrémistes bellicistes. Lors de la guerre du Golfe, l'Irak a attaqué le Koweït car il savait précisément que ce petit pays n'était pas en moyen de se défendre. Pour éviter les ennuis, il faut donc que les pays éventuellement hostiles comprennent qu'il est inutile de vouloir s'en prendre à l'intégrité du territoire national. Seule une politique de vigilance permanente ne sous-estimant aucun risque permet de maintenir des effectifs armés suffisants et adaptés afin de dissuader de possibles ennemis de tenter leur chance à agresser notre pays. Il est d'ailleurs assez terrifiant que lorsque l'Allemagne nazie se réarmait dans les années trente, la France ait longuement tardé à prendre la mesure de la menace. Cela ne faisait qu'augurer l'étendue du désastre qu'une position trop pacifiste a permise, comme la débâcle de 1940 l'a montré.
Nous devons donc faire face à plusieurs menaces : d'abord, les pays hostiles disposant d'armées. C'est le cas avec l'Iran, qui se cache à peine de vouloir l'arme nucléaire alors que rien ne laisse penser que son gouvernement puisse être assez sage pour disposer d'une arme aussi destructrice. C'est aussi le cas avec la Corée du Nord, qui elle se targue même de l'avoir, et dont les névroses de son chef suprême laissent craindre le pire. Mais il y aussi la menace de la guérilla, que doivent affronter nos armées en Afghanistan, ou bien celle encore plus difficile à gérer, celle des kamikazes, car la raison est exclue du domaine de l'ennemi. On voit en Israël ou en Irak les difficultés que ceux-ci posent. Les armées doivent être donc prêtes à faire face à chacune de ces menaces. Des soldats issus de la conscription n'étaient plus en mesure de pouvoir le faire, l'armée a donc du se professionnaliser pour acquérir les connaissances et l'expérience nécessaires à la gestion de ces situations. Les effectifs de l'armée professionnelle augmentent donc, les investissements en matériel militaire également, étant donné la sophistication croissante des armes et des moyens utilisés pour répondre au mieux à ce genre de menaces. Bref, le moment n'est certainement pas venu pour la défense nationale de se voir couper les crédits. Le plus sage serait de lui donner les moyens nécessaires à son efficacité, car nous ne pouvons nous permettre d'encourir le moindre risque, d'avoir le moindre doute aux moments où des vies sont en jeu.
 A Bruxelles, les lobbyistes professionnels ont un accès permanent tant à la Commission européenne qu'au Parlement européen. Ils sont consultés par les commissaires pour que ces derniers puissent prendre leurs décisions, et rencontrent fréquemment les députés européens pour faire valoir les intérêts des clients de lobbys lors des votes. Les lobbyistes sont justement embauchés par des entreprises ou des associations économiques sectorielles pour qu'ils s'attellent à convaincre les preneurs de décisions, en l'occurrence les personnalités politiques, d'adopter des mesures qui aillent dans le sens de leurs intérêts. Dans la capitale européenne, il semble que leur présence ne pose pas de problème. C'est assez étonnant dans la mesure où les lobbys profitent ouvertement des méandres de la bureaucratie et qu'ils apparaissent donc comme particulièrement obscurs, contraires à l'idée de transparence dans les institutions européennes. C'est fâcheux, un an après le rejet du traité constitutionnel européen, il serait temps de faire le ménage sur les points qui affaiblissent la construction européenne lorsqu'ils la desservent. Les lobbys en sont clairement les parasites, vu le flou des moyens qu'ils adoptent pour "convaincre" les responsables politiques, voire pour leur forcer la main.
A Bruxelles, les lobbyistes professionnels ont un accès permanent tant à la Commission européenne qu'au Parlement européen. Ils sont consultés par les commissaires pour que ces derniers puissent prendre leurs décisions, et rencontrent fréquemment les députés européens pour faire valoir les intérêts des clients de lobbys lors des votes. Les lobbyistes sont justement embauchés par des entreprises ou des associations économiques sectorielles pour qu'ils s'attellent à convaincre les preneurs de décisions, en l'occurrence les personnalités politiques, d'adopter des mesures qui aillent dans le sens de leurs intérêts. Dans la capitale européenne, il semble que leur présence ne pose pas de problème. C'est assez étonnant dans la mesure où les lobbys profitent ouvertement des méandres de la bureaucratie et qu'ils apparaissent donc comme particulièrement obscurs, contraires à l'idée de transparence dans les institutions européennes. C'est fâcheux, un an après le rejet du traité constitutionnel européen, il serait temps de faire le ménage sur les points qui affaiblissent la construction européenne lorsqu'ils la desservent. Les lobbys en sont clairement les parasites, vu le flou des moyens qu'ils adoptent pour "convaincre" les responsables politiques, voire pour leur forcer la main. C'est probablement ce qui se rapproche le plus d'une conspiration mondiale. Le think tank Project for the New American Century a été créé à la fin des années 1990 pour promouvoir la domination de l'Amérique sur le monde au XXIème siècle. Cette assemblée de néo-conservateurs souhaite que les Etats-Unis restent une puissance militaire très forte, afin de pouvoir garder la main sur les affaires mondiales et les orienter dans leur sens, avec l'intime conviction que ce qui profite aux Etats-Unis profite au monde entier. Il n'est donc pas étonnant de compter dans leurs rangs de multiples faucons, la plupart affiliés au parti républicain. En effet, puisque c'est la posture rigide de Ronald Reagan qui a permis à l'Amérique de l'emporter contre l'URSS, pourquoi devrait-elle relâcher ses efforts contre ses nouveaux ennemis, en l'occurrence les terroristes islamiques, ou de façon plus vaste tous ceux qui ne sont pas explicitement ses alliés ?
C'est probablement ce qui se rapproche le plus d'une conspiration mondiale. Le think tank Project for the New American Century a été créé à la fin des années 1990 pour promouvoir la domination de l'Amérique sur le monde au XXIème siècle. Cette assemblée de néo-conservateurs souhaite que les Etats-Unis restent une puissance militaire très forte, afin de pouvoir garder la main sur les affaires mondiales et les orienter dans leur sens, avec l'intime conviction que ce qui profite aux Etats-Unis profite au monde entier. Il n'est donc pas étonnant de compter dans leurs rangs de multiples faucons, la plupart affiliés au parti républicain. En effet, puisque c'est la posture rigide de Ronald Reagan qui a permis à l'Amérique de l'emporter contre l'URSS, pourquoi devrait-elle relâcher ses efforts contre ses nouveaux ennemis, en l'occurrence les terroristes islamiques, ou de façon plus vaste tous ceux qui ne sont pas explicitement ses alliés ?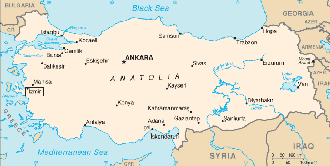 Le débat a duré une quarantaine de minutes, et n'est même pas arrivé au vote. Hier, l'Assemblée Nationale se penchait sur la question du génocide arménien, déjà reconnu, et surtout de la possibilité d'interdire son négationnisme. Il est assez savoureux de remarquer que le Parti Socialiste a déposé un projet de loi légiférant sur l'Histoire, alors qu'il avait justement rejeté celui qui visait à reconnaître officiellement les bienfaits apportés par la colonisation française. Si c'était le droit qu'ont les hommes politiques à énoncer l'Histoire qui était alors en question, qu'en est-il aujourd'hui ? Un autre aspect amusant de ce projet de loi est qu'il est l'exact contraire de ce qui est en Turquie, où pour le coup il est interdit d'affirmer que les Turques aient pu commettre un génocide sur le peuple arménien lors de la première guerre mondiale. La Turquie a d'ailleurs menacé la France de représailles diplomatiques si jamais ce projet de loi venait à être adopté, et c'était bien le seul argument qu'a faiblement défendu Philippe Douste-Blazy en exhortant les députés de rejeter le texte. Il faut dire que la Turquie n'entretient déjà pas des relations de premier ordre avec la France. En cause, la loi française contre le port du foulard islamique à l'école, mal vu par le président de la Turquie, un islamiste "modéré" à la tête d'une république pourtant laïque. En cause aussi, cette reconnaissance du génocide arménien. En cause surtout, le fait qu'une grande majorité de la population française refuse l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne.
Le débat a duré une quarantaine de minutes, et n'est même pas arrivé au vote. Hier, l'Assemblée Nationale se penchait sur la question du génocide arménien, déjà reconnu, et surtout de la possibilité d'interdire son négationnisme. Il est assez savoureux de remarquer que le Parti Socialiste a déposé un projet de loi légiférant sur l'Histoire, alors qu'il avait justement rejeté celui qui visait à reconnaître officiellement les bienfaits apportés par la colonisation française. Si c'était le droit qu'ont les hommes politiques à énoncer l'Histoire qui était alors en question, qu'en est-il aujourd'hui ? Un autre aspect amusant de ce projet de loi est qu'il est l'exact contraire de ce qui est en Turquie, où pour le coup il est interdit d'affirmer que les Turques aient pu commettre un génocide sur le peuple arménien lors de la première guerre mondiale. La Turquie a d'ailleurs menacé la France de représailles diplomatiques si jamais ce projet de loi venait à être adopté, et c'était bien le seul argument qu'a faiblement défendu Philippe Douste-Blazy en exhortant les députés de rejeter le texte. Il faut dire que la Turquie n'entretient déjà pas des relations de premier ordre avec la France. En cause, la loi française contre le port du foulard islamique à l'école, mal vu par le président de la Turquie, un islamiste "modéré" à la tête d'une république pourtant laïque. En cause aussi, cette reconnaissance du génocide arménien. En cause surtout, le fait qu'une grande majorité de la population française refuse l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne. Moins évident est le cas de l'Iran. Solidement financé par les revenus pétroliers, ce pays est à nouveau prêt à tous les conflits qui peuvent être causés par une lecture délirante du Coran. Malgré le régime islamique mis en place en 1979, cela peut encore aller lorsque ce sont les "modérés" qui sont au pouvoir, mais depuis que Mahmoud Ahmadinejad est aux commandes, nous sommes revenus aux situations les plus dangereuses. En particulier, le souhait de l'Iran de disposer d'installations nucléaires parait particulièrement terrifiant lorsque l'on sait qu'Ahmadinejad souhaite voir Israël "rayé de la carte". Le nucléaire permet des applications dont la puissance n'égale que la dangerosité, et ne serait-ce qu'entretenir une centrale électrique nucléaire est une responsabilité qu'il ne faut pas sous estimer. Nous nous sommes sortis de la guerre froide sans champignon atomique que parce que les dirigeants des deux blocs avaient le sang froid suffisant et un sens des responsabilités minimal. Et encore, nous avons connu des situations bien risquées à ce niveau là. Mais peut on espérer ce même sens des responsabilités de la part de quelqu'un comme Ahmadinejad, alors que jusqu'à présent il ne l'a jamais montré ?
Moins évident est le cas de l'Iran. Solidement financé par les revenus pétroliers, ce pays est à nouveau prêt à tous les conflits qui peuvent être causés par une lecture délirante du Coran. Malgré le régime islamique mis en place en 1979, cela peut encore aller lorsque ce sont les "modérés" qui sont au pouvoir, mais depuis que Mahmoud Ahmadinejad est aux commandes, nous sommes revenus aux situations les plus dangereuses. En particulier, le souhait de l'Iran de disposer d'installations nucléaires parait particulièrement terrifiant lorsque l'on sait qu'Ahmadinejad souhaite voir Israël "rayé de la carte". Le nucléaire permet des applications dont la puissance n'égale que la dangerosité, et ne serait-ce qu'entretenir une centrale électrique nucléaire est une responsabilité qu'il ne faut pas sous estimer. Nous nous sommes sortis de la guerre froide sans champignon atomique que parce que les dirigeants des deux blocs avaient le sang froid suffisant et un sens des responsabilités minimal. Et encore, nous avons connu des situations bien risquées à ce niveau là. Mais peut on espérer ce même sens des responsabilités de la part de quelqu'un comme Ahmadinejad, alors que jusqu'à présent il ne l'a jamais montré ?