dimanche 30 septembre 2007
Par xerbias,
dimanche 30 septembre 2007 à 14:48 :: General

C'est à peu près le but de tous les ministres de la culture qui se sont succédés : démocratiser la culture, pour que se résorbe une partie du déficit en capital culturel qu'a une grande partie de la population vis-à-vis de la population. Actuellement, la principale mesure à l'étude pour y arriver serait d'instituer la gratuité des musées. Une telle mesure serait évidemment coûteuse, et de surcroît elle ne serait peut-être pas justifiée. En effet, pour les plus grands musées français, les rentrées financières représentées par la vente de billet permettent non seulement l'entretien de ces musées, mais aussi le financement d'autres musées ou monuments non rentables à eux seuls. De plus, ces lieux attirent de nombreux touristes étrangers, qui représentent avant tout une source d'argent pour la France, plutôt qu'un public à qui il faudrait faciliter l'accès à la culture. Surtout, les musées ont d'ores et déjà une grande panoplie de réductions en tous genres pour rendre peu coûteux la visite au public. De nombreux musées, comme le Louvre ou le musée d'Orsay, sont déjà totalement gratuits le premier dimanche du mois, et le Château de Versailles, qui est également un lieu de culture, est gratuit pour tous les mineurs. Christine Albanel, l'actuelle ministre de la culture, doit bien le savoir, puisqu'elle était présidente de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles avant d'entrer dans le gouvernement. Forte de cette expérience, elle a choisi une voie sage en ne faisant qu'expérimenter cette gratuité pendant un semestre dans des musées de petite taille, qui attirent avant tout un public local.
Dans le cadre d'une politique culturelle, il faut bien distinguer les natures des réticences du public vis-à-vis de la culture. Il y a deux situations qui empêchent l'accès à la culture : d'une part elle est considérée comme trop cher, d'autre part, il y a souvent un grand manque d'envie de se cultiver, dans le sens de la culture telle que l'entend l'élite qui déplore le manque de culture du reste de la population. Dans le domaine de la culture, les élitistes aimeraient bien que leur passion soit partagée par tous. Ils imaginent que le faible accès à la culture résulte soit d'un manque de l'offre, soit d'un manque de moyens. C'est parfois vrai, mais cela a des limites. Tout le monde ne souhaite pas forcément regarder des opéras, des pièces de théâtre d'art expérimentales ou contempler des œuvres d'art moderne. De la même manière, les musées devenus gratuits, ne représenteront pas forcément une destination privilégiée de loisirs pour la population. Nombreux sont ceux qui déplorent le niveau des programmes de télévision, mais ils oublient souvent que depuis une quinzaine d'années maintenant, Arte propose chaque soir des programmes culturels ou d'un niveau élevé. Seulement, son audience tourne la plupart du temps autour des 5 % de parts de marché. Et sur les autres chaînes du service public, passer de la musique classique, des classiques du théâtre ou de l'opéra se traduit presque invariablement par une désaffection du public. L'intérêt pour les documentaires est variable, selon la façon dont ils sont réalisés. Si la diffusion de tels programmes est nécessaire pour laisser une liberté de choix, son manque de succès montre néanmoins la limite du fait de vouloir "cultiver" de force la population en ne lui laissant pas le choix de ses distractions.
C'est quelque chose dont il faudrait tenir compte lorsque l'on parle de politique culturelle. Si la diversité de la création culturelle est souhaitable, cela ne suffit pas à justifier certaines subventions publiques vers des œuvres qui ne trouvent grâce qu'auprès d'une infime minorité du public. Il est par exemple étonnant que les pouvoirs publics achètent des monochromes pour les compter ensuite au patrimoine national, ou subventionnent certaines pièces de théâtre sans tenir compte de leur affluence. Dans ces temps de réduction de la dépense publique, le mieux est encore de concentrer le budget de la culture vers l'accès au patrimoine commun qui s'est formé au fil des siècles, plutôt que de faire vivre artificiellement une création qui n'intéresse parfois que les créateurs. A ce titre, le rôle des bibliothèques est tout à fait fondamental, pour que ceux qui souhaitent accéder à la connaissance n'en soit pas empêchés. Il est également possible, dans le but justement de démocratiser la culture, d'adopter des mesures peu coûteuses qui bénéficieraient au public, comme la fin du prix unique du livre. Aujourd'hui, les livres qui ne sortent pas en livres de poches ont des prix peu attrayants pour une majorité du public. Peut-être la concurrence entre les différents distributeurs pourrait contribuer à diminuer le prix des livres, et donc que les volumes écoulés soient plus élevés ?
Photo : Didier Plowy/MCC
aucun commentaire
:: aucun trackback
vendredi 28 septembre 2007
Par xerbias,
vendredi 28 septembre 2007 à 23:02 :: Europe
A l'origine, la construction européenne a été entreprise pour faire la paix entre des pays qui se faisaient la guerre depuis des siècles. Après tout, entre la France, l'Italie et l'Allemagne, on s'étripe depuis le temps de l'Empire romain, à l'époque où ces pays étaient des peuples appelés les Gaulois, les Romains et les Germains. Mais il est possible de remonter encore plus loin dans les chroniques des guerres célèbres, seulement, pour cela, il est nécessaire de chercher un peu plus à l'est autour de la Méditérannée. Il y a bien sûr l'éternel conflit du moyen orient, qui semble être la conséquence de quelque décision divine, et dont personne ne verra la fin. Il y a aussi l'opposition entre les Grecs et les Turcs dont on retrouve la trace jusqu'à la guerre de Troie, les différentes cités grecques s'étant liguées pour affronter les Troyens dans un conflit resté fameux grâce au récit qu'en a fait Homère. Plus de 3000 ans après, les relations entre la Grèce et la Turquie sont toujours compliquées de nos jours, avec comme principal point d'acchoppement la question des zones d'influences sur la Méditérannée. Le règlement de la division de l'île de Chypre en est un exemple flagrant, mais ce n'est pas la seule île dont la souveraineté fait l'objet de tensions. Tout au long de l'après deuxième guerre mondiale, les incidents entre la Grèce et la Turquie se sont succédés dans la Méditerranée.
Aujourd'hui, la Grèce est devenue une démocratie européenne tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et n'est donc plus tentée de faire du nationalisme à bon compte en prenant pour cible l'ennemi héréditaire turc. De son côté, la Turquie aimerait pouvoir rentrer dans l'Union Européenne pour pouvoir avoir une plus grande influence sur la scène internationale. Pour cela, elle est forcée d'adoucir ses positions en matière de politique étrangère. Cela n'est pas forcément évident, le nationalisme y ayant une vigueur encore dangereuse. Si toutes les tensions ne sont pas évacuées entre les deux pays, ils ont actuellement arreté de se voir comme d'implacables ennemis. La situation pourrait pourtant ne pas durer. Un regain de nationalisme pourrait remettre en cause ce nouvel équilibre, tout comme un éventuel passage de la Turquie dans le camps des Etats islamiques.
Au vu de la force du sentiment religieux militant en Turquie, cette dernière possibilité pourrait se faire de façon naturelle, par les urnes. Bon nombre d'experts en politique étrangère font d'ailleurs la promotion de l'adhésion turque dans l'Union Européenne pour cette raison de géopolitique : si on venait à lui refuser l'entrée, la Turquie pourrait être amenée à se brusquer et à prendre le parti de l'islamisme, devenant une menace douloureuse aux portes de l'Europe. C'est l'analyse que fait par exemple Michel Rocard, qui ayant abandonné tout espoir de fédéralisme européen se résoud à sacrifier l'Union Européenne pour éviter une menace turque, ainsi que Jacques Chirac, qui en tant que Président de la République française s'était fait l'ardent défenseur de la candidature turque.
C'est pourtant une analyse bien douteuse. Si la Turquie venait à entrer dans l'Union Européenne, cette dernière aurait dès ce moment une frontière avec des pays difficiles comme l'Irak ou l'Iran. De plus, rien ne garantit qu'une adhésion pourrait bloquer avec certitude la menace islamique en Turquie si elle est aussi forte que les pro-adhésions turque semblent le penser. Ce qui la rendrait dans ce cas encore plus alarmante. Surtout, la Turquie n'est en aucun cas condamnée à l'islamisme, et c'est justement refuser de croire en elle que de parier sur un tel scénario. Il n'y a pas de fatalité à éviter sans qu'on ait le choix de faire autre chose que de faire adhérer la Turquie. Car actuellement, le procédé relève de l'intimidation. Et ce n'est certainement pas le moyen de favoriser la paix et l'amitié entre les peuples.
aucun commentaire
:: aucun trackback
mercredi 26 septembre 2007
Par xerbias,
mercredi 26 septembre 2007 à 14:08 :: Pensée politique
Au fond, quel est le principal problème de notre société ? Les inégalités répondront bon nombre de gens. Or ce n'est pas tant les inégalités qui posent problème, mais plutôt le fait qu'elles soient vues comme une fatalité, inévitable, qu'une naissance dans un milieu défavorisé soit considérée comme une condamnation à y passer sa vie. Que ce soient les questions de couleurs de peau, d'accès au logement, au travail, à la réussite financière ou de systèmes de retraites, l'important est qu'il n'y ait pas de milieux clos. A ce titre, le principe fondamental qui devrait régir notre société devrait être l'égalité des chances. Un enfant devrait pouvoir envisager toutes les carrières et choisir son propre destin, où son succès dépendra de son talent, des compétences qu'il aura acquises et de ses éventuelles prises de risque. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. La reproduction sociale est encore très forte, peut-être même plus forte qu'autrefois si l'on en croit les statistiques de la catégorie socio-professionnelle des parents des élèves de classes préparatoires. Moins de 10 % d'entre eux sont enfants d'ouvriers, ce qui est considérablement moins qu'après guerre. Divers mécanismes sociologiques participent à ce phénomène. Le manque de capital social ou culturel, le fait que l'école demande aux enfants d'être performants dans des domaines qu'elle n'enseigne pas, mais qui sont transmis par le milieu familial, ou bien les effets de ghetto dus aux regroupements de foyers modestes dans les mêmes zones géographiques, avec un mécanisme de cercle vicieux quant aux prix des logements qui y sont pratiqués.
Techniquement, la réussite dans les études supérieures repose bien sur la méritocratie. Les élèves des grandes écoles sont recrutés à partir de concours difficiles, mais dont chacun a accès. Les classes préparatoires sont gratuites dans l'enseignement public, et les élèves y sont recrutés à partir de leurs notes scolaires au lycée. A l'université, il suffit d'avoir le baccalauréat pour s'inscrire en DEUG. Mais les taux d'échecs y sont conséquents. On parle d'une possible sélection des étudiants en faculté, elle se ferait alors essentiellement sur le dossier scolaire. Mais dès le niveau du lycée, les taux d'accès au baccalauréat des enfants issus des différents milieux sociaux varient énormément. Ces différences se font dès la primaire, peut être même avant, et continuent de se faire tout au long de la vie professionnelle.
Alors ce problème fondamental est effectivement bien ancien. Mais il faut le garder constamment à l'esprit, pour continuer à chercher comment combattre le scandale qu'est l'inégalité des chances, pour faire valoir l'idéal méritocratique qui doit devenir la règle. Est-ce par la discrimination positive, c'est-à-dire donner plus de chances à ceux qui en ont moins au départ ? Pourquoi pas. Les symboles ont aussi un certain rôle dans la conscience collective. En l'occurrence, la nomination de Rachida Dati, fille d'immigrés maghrébins, au ministère de la Justice a représenté un grand coup qui a marqué les esprits, et ce d'autant plus qu'elle en avait les compétences techniques, en étant magistrate, et politique, en ayant été porte-parole de Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle. Ce symbole, visible, aurait été moins fort si à la place cela aurait été Patrick Devedjian qui avait été à ce poste comme il y était pressenti, alors que lui aussi, il est fils d'immigré (arménien), connaisseur du droit (en tant qu'avocat) et de la chose politique (par une grande expérience au sein des partis de droite).
Quoi qu'il en soit, au-delà des baronnies ou des castes, ce souci de récompenser l'effort et les compétences doit prédominer. C'est une approche différente que de considérer les inégalités en général comme en soi mauvaises et injustifiées, les égalités importantes sont celles des chances, et du traitement devant la loi, il doit rester possible d'améliorer sa propre position par ses efforts.
aucun commentaire
:: aucun trackback
lundi 24 septembre 2007
Par xerbias,
lundi 24 septembre 2007 à 23:16 :: Monde

En 1994 le déficit du budget de l'Etat canadien atteignait un montant représentant 5,3 % du PIB, et la dette publique dépassait largement les 60 % du PIB. Elu avec un mandat fort en matière d'assainissement des finances publiques, le Premier ministre Jean Chrétien s'est efforcé de rétablir l'équilibre budgétaire via un effort colossal en matière de réduction des dépenses publiques. Et avec succès, puisque quelques années plus tard l'Etat canadien retrouvait un excédent budgétaire, et dès 1995 le montant de la dette a commencé à diminuer en proportion du PIB. Depuis 1998, le budget canadien est excédentaire, et en 2005 la dette publique représentait moins de 40 % du PIB. Une remise en état aussi spectaculaire fait évidemment envie aux responsables français, et certaines personnalités politiques ont fait le voyage au Canada pour y prendre des leçons en matière de réforme de l'Etat.
C'est ainsi que le Sénat notamment a consacré un rapport très intéressant sur ce sujet, à l'occasion d'une visite au pays à la feuille d'érable faite sur le chemin vers Saint-Pierre et Miquelon. On y découvre comment le gouvernement a supprimé plus de 6 % des postes de fonctionnaires fédéraux entre 1994 et 1999. Pour cela, des indemnités de départ ont été prévues, ainsi qu'un organisme entièrement dévolu au reclassement des agents partants. Les rémunérations des agents publics ont très peu augmenté depuis la réforme, ayant même été gelées entre 1994 et 1997. Le nombre des ministères a été drastiquement réduit, et chacun d'entre eux a vu une baisse de ses crédits à deux chiffres, le tout pour arriver à une baisse de 20 % des dépenses publiques. Certains services d'intérêt général ont été délégués au secteur privé au passage. Tout le processus a suivi une concertation incessante, facilité par un encadrement très strict du droit de grève.
En outre, pour maintenir la qualité des comptes publics, des indicateurs de performance des services publics ont été créés, une grande transparence de l'utilisation de l'argent public a été établie et le contrôle y est pris au sérieux. Toute l'organisation des services publics a été repensée, notamment via l'établissement de guichets uniques et d'administrations en ligne. De même, les fonctions supports des différentes administrations ont été regroupées pour générer davantage d'économies. Encore aujourd'hui, les efforts de rationalisation sont poursuivis.
Evidemment, ce modèle canadien n'a pas à être reproduit tel quel en France. Déjà, l'Etat canadien est fédéral, ce qui change pas mal de choses. De plus, le Canada a du réembaucher par la suite pour certains postes, la suppression d'effectif ayant entraîné une dégradation des conditions de travail et une perte d'expertise. Néanmoins, l'opération reste largement bénéfique pour le pays. Les Canadiens eux-mêmes ne supportaient plus que 37 % des recettes fiscales du pays soient consacrés au service de la dette fédérale. Aujourd'hui, en France, le service de la dette représente plus de 40 milliards d'euros... soit le montant du déficit public justement.
aucun commentaire
:: aucun trackback
samedi 22 septembre 2007
Par xerbias,
samedi 22 septembre 2007 à 17:44 :: General

La séparation des pouvoirs distingue nettement le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Elle permet d'éviter une dangereuse concentration des pouvoirs dans les mains d'une seule personne, et donc protège le peuple du totalitarisme. Mais ces derniers temps, de nombreuses polémiques éclatent, où le pouvoir judiciaire reproche à l'exécutif de tenter d'interférer dans son fonctionnement, et de ne pas respecter de fait cette séparation. Le torchon brûlait déjà entre les magistrats et Nicolas Sarkozy, lorsque celui-ci était ministre de l'Intérieur. Depuis que ce dernier est devenu Président de la République, et donc Président de la République, les mêmes récriminations perdurent, surtout depuis que Rachida Dati est devenue ministre de la Justice en voulant appliquer la volonté présidentielle. Il faut dire que les syndicats de magistrats ont des avis sur tout ce qui touche la justice française : après avoir vaillamment défendu le juge Burgaud lorsqu'il s'est avéré que celui-ci avait mené une instruction exclusivement à charge dans l'affaire d'Outreau, ils ont combattu la plupart des lois demandées par Nicolas Sarkozy pour combattre l'insécurité, et contestent farouchement le fait que l'on puisse ne pas être d'accord avec une décision de justice. Ainsi, chaque remarque faite par un membre du Parlement ou un ministre sur les décisions rendues par les tribunaux est considérée comme une tentative d'influencer le système judiciaire français, et donc de ne pas respecter la séparation des pouvoirs. En même temps, la loi de la peine plancher sur les multi-récidives est combattue dans la mesure où les juges ont moins de latitude pour fixer la peine, certains juges préfèrent même ne pas reconnaître consciemment certains faits pourtant avérés pour ne pas voir cette nouvelle loi s'appliquer, et lorsqu'un procureur exprime sa volonté de ne pas appliquer la loi, les syndicats de magistrats s'émeuvent que l'on puisse considérer cela comme anormal.
Les juges peuvent alors se demander pour quelle raison leurs concitoyens commencent à se méfier de plus en plus de leur système judiciaire. Car en agissant ainsi, les magistrats laissent penser qu'ils ne sont plus là pour appliquer la loi, mais pour mettre en œuvre leur propre vision de la Justice. Or s'ils veulent s'attribuer un véritable pouvoir politique, encore faudrait-il qu'ils en aient la légitimité. Dans ce cas, quelle est la légitimité des magistrats pour agir ? En partant du principe que la légitimité est issue du peuple, le lien n'est pas toujours évident. Pour les magistrats du parquet, il s'agit de représentants du ministère public. Ils ne sont pas formellement indépendants, leur légitimité venant de l'administration du ministère de la justice. Dans les cours d'assises, les conseils de prud'hommes ou les tribunaux de commerce, les décisions rendues sont prises par respectivement des membres de jurys tirés au sort dans le corps électoral et des personnalités élues par leurs pairs, au sein de la société civile. Pour d'autres juridictions, telles que les tribunaux correctionnels, il n'y a qu'un juge professionnel, nommé par une hiérarchie dirigée par des juges eux-mêmes élus par la base de leurs pairs. Les magistrats professionnels du siège sont donc un corps qui s'auto-gère et s'auto-contrôle, sans que le peuple n'y soit représenté d'une quelconque façon. Alexis de Tocqueville, dans la
Démocratie en Amérique, évoquait le cas des juges élus qu'il avait rencontré dans son voyage de l'autre côté de l'Atlantique. Une telle possibilité n'est évidemment pas possible de nos jours en France, de par la taille du pays d'une part, de par les luttes d'influences malsaines que cela entraînerait d'autre part. Il est donc difficile de vouloir renforcer la représentation du peuple dans ce corps de magistrats professionnels du siège.
En conséquence il y a bien un manque de légitimité pour qu'ils puissent constituer un pouvoir politique. Ils n'ont donc pas à vouloir mettre en œuvre leurs propres considérations sur la société, et doivent davantage s'attacher à appliquer la loi. Le fait qu'il y ait des bornes supérieures et inférieures pour les peines à prononcer contre les multi-récidivistes n'empêche pas qu'ils ont toujours la liberté de juger de ce qu'il s'est passé, du moment qu'ils le font avec leur véritable intime conviction, et de choisir la peine dans l'éventail qui est disponible. De ce fait, leur indépendance n'est menacée d'aucune manière. Et si eux refusent que les personnalités politiques critiquent leurs propres décisions, pourquoi vouloir interférer dans le domaine politique en voulant y exercer une influence ? Il serait même possible de dire alors que l'indépendance des pouvoirs exécutifs et législatifs et judiciaires est menacée par les débordements du pouvoir judiciaire. Il est vrai que cette volonté d'appliquer son propre agenda qui apparaît chez les magistrats vient surtout de leurs syndicats. Les deux principaux, le Syndicat de la Magistrature et l'Union Syndicale de la Magistrature, sont respectivement de gauche d'un côté, et clairement pas de droite de l'autre. A prendre en permanence la parole dans les médias, ils laissent penser que la magistrature est orientée politiquement, et donc que les décisions rendues par le système judiciaire français sont biaisées ou orientées d'une certaine façon. Voilà qui n'est sûrement pas pour servir la sérénité de la justice. Il ne leur est pourtant demandé que d'appliquer la loi.
un commentaire
:: aucun trackback
jeudi 20 septembre 2007
Par xerbias,
jeudi 20 septembre 2007 à 16:34 :: Europe
L'image de la Roumanie en France est celle d'un pays très pauvre, l'un des plus pauvres de l'Europe. Si le pays n'a jamais vraiment été dans le groupe de tête des pays les plus influents d'Europe, la période communiste n'a pas facilité non plus le développement économique roumain. Pourtant, cette perception de grande pauvreté est probablement surtout due au fait qu'il y a une certaine confusion en France entre la population nomade des Roms, qui sont originaires de Roumanie, et l'ensemble des Roumains. Aux Roms sont souvent associés l'idée qu'ils survivent par la mendicité et les vols, une image semblable à la plupart des gens du voyage. L'ouverture des frontières a permis l'entrée de nomades roms en France, fuyant la pauvreté dans leur pays d'origine, et laissant penser que la Roumanie étant effectivement un pays où règne une grande pauvreté. En fait, les Roms souffrent bien de pauvreté en Roumanie, mais ce n'est pas forcément le cas du reste des Roumains, qui forment une majorité ethnique. Dans son ensemble, la Roumanie est loin d'aller aussi mal que cela, bien au contraire. A l'instar du reste de l'Europe de l'est, la fin de l'emprise soviétique (traduite là-bas par une spectaculaire révolution contre le dictateur communiste local, Ceausescu) a permis une forte croissance, résultat d'un phénomène de rattrapage vis-à-vis des pays de l'Europe de l'ouest.
Ainsi, la Roumanie s'est fortement développée dans la dernière décennie, connaissant des taux de croissance largement supérieurs à 5 %. Certes, la base initiale fait qu'il faudra encore du temps pour que la Roumanie arrive à un niveau semblable de PIB par habitant à ne serait-ce que celui de pays comme la Hongrie. Il reste une véritable hétérogénéité des niveaux de vie dans les pays de l'Europe centrale et orientale. Mais la forte croissance de la Roumanie se fait non seulement sur sa main d'œuvre bon marché, mais également sur la création de véritables compétences technologiques dans divers domaines, comme celui des machines outils. Le succès des voitures Logan, produite par le fabricant local Dacia dans le cadre d'une alliance avec Renault, en Roumanie mais aussi dans le reste de l'Europe est un symbole de ce qui peut y être fait en terme de produits de qualité et de faibles coûts. Avec la Bulgarie, la Roumanie est entrée dans l'Union Européenne le 1er janvier dernier, et s'attèle désormais à atteindre les critères de Maastricht pour pouvoir adopter l'euro. Dans ce cadre, les finances publiques sont saines : les déficits publics représentent moins de 3 % du PIB, et la dette publique elle ne représente que 20 % du PIB, ce qui est bien loin des 65 % français. Le seul obstacle restant à l'adoption de l'euro est l'inflation assez forte, de l'ordre de 6 %, conséquence de la surchauffe de l'économie roumaine. De même, la Roumanie fait bien mieux que plusieurs pays d'Europe de l'est, et en premier lieu la France, avec un taux de chômage qui tourne autour des 4,5 %.
Vu comme cela, il y a bien moins lieu de s'inquiéter pour ce pays qui se développe très vite, de la même manière d'ailleurs que sa voisine la Bulgarie. La persistance de la présence des Roms en France est plus la conséquence d'une discrimination en Roumanie (et qui existe aussi en France d'ailleurs) que l'absence de perspectives de développement pour le pays. Si le chemin du rattrapage est encore long pour la Roumanie, celle-ci peut au moins se féliciter que l'horizon soit dégagé pour elle.
2 commentaires
:: aucun trackback
mardi 18 septembre 2007
Par xerbias,
mardi 18 septembre 2007 à 22:27 :: Pensée politique

De nos jours, le mot est lancé facilement, comme une insulte. Est poujadiste celui qui trouve qu'il y a trop de fonctionnaires et le niveau d'imposition trop élevé. A l'origine, le mot vient de Pierre Poujade, un libraire qui se lança en 1953 dans une croisade contre la fiscalité, et qui fut rapidement rejoint par de nombreux autres petits commerçants. Le mouvement, d'abord syndical, devint ensuite politique, et remporta un succès surprenant aux élections législatives de 1956, en réunissant plus de 11 % des suffrages, ce qui fit élire 52 députés sous les couleurs de l'Union et fraternité française, et en premier lieu Pierre Poujade lui-même. Ce mouvement avait sans conteste bénéficié des errements de la IVème République, de la médiocrité des gouvernements qui se succédaient rapidement, tant et si bien que le slogan "sortez les sortants" suffisait à fédérer la colère contre la classe politique en place. Il faut d'ailleurs noter que ce succès électoral fut très limité dans le temps, le mouvement de Pierre Poujade ne retrouvant pas les faveurs de l'électorat lorsque celui constatera à partir de 1958 qu'il y a à nouveau un capitaine sur le bateau, en la personne du Général de Gaulle.
A l'époque comme aujourd'hui, le poujadisme était vu comme un populisme. En effet, les thématiques déployées par ce mouvement étaient souvent démagogiques, mais les critiques contre l'inefficacité du Parlement de l'époque ou contre la fiscalité excessive ne peuvent disqualifier dès le départ celui qui émet un tel message. Après tout, le système parlementaire de la IVème République était bel et bien catastrophique. Et le niveau de la fiscalité française reste élevé, et décourage parfois les créateurs de richesse. A ce titre, Pierre Poujade apparaît comme le représentant d'un trait très français, le fait de râler et de protester de façon véhémente. La France est habituée à ce que des syndicalistes de gauche usent de telles postures pour défendre leurs revendications, et plus personne ne s'en étonne. Mais lorsqu'il s'agit d'un syndicaliste défendant le petit commerce, le voilà classé comme un réactionnaire extrémiste. Surtout que le reproche de populisme est bien souvent une manière pour ceux qui sont élitiste de rejeter d'un geste l'opinion de la population qui n'est pas d'accord avec eux.
Néanmoins, les positions des poujadistes (refus de la construction européenne, défense de l'Algérie française) les classent tout de même bien à droite sur l'échiquier politique de l'époque. Il avait hébergé le jeune Jean-Marie Le Pen, alors plus jeune député de France, qui reprit ensuite à son compte une partie des thèmes du mouvement poujadiste. Cette forme de pensée constitue d'ailleurs toujours l'une des composantes du Front National, avec les catholiques traditionalistes et les authentiques racistes. Mais dans l'analyse historique du mouvement poujadiste des années 50, ce qui apparaît en fin de compte comme le plus gênant est son corporatisme forcené, alors que l'intérêt général doit toujours le seul but à rechercher. C'est, du reste, un trait commun à tous les syndicats. Et c'est justement la raison pour laquelle ceux-ci ne doivent pas entrer sur le terrain politique, dans les échéances électorales.
Photo : Hulton Archive/Getty Images
13 commentaires
:: aucun trackback
dimanche 16 septembre 2007
Par xerbias,
dimanche 16 septembre 2007 à 18:51 :: Monde

La chancelière allemande Angela Merkel a décidé de rencontrer le Dalaï Lama, dirigeant en exil du Tibet, et autorité de la religion bouddhique récompensée du prix Nobel de la paix. Evidemment, cette démarche provoque la fureur du gouvernement chinois, qui voit dans ce moine pacifiste un agent séparationniste, alors que celui-ci ne prône même pas l'indépendance de son pays pourtant militairement conquis il y a plus de cinquante ans, mais seulement l'autonomie. La Chine, qui considère le Tibet comme l'une de ses provinces, n'entend pas que le Tibet ait un quelconque régime spécial. D'une part, la nature nationaliste du pouvoir en place en Chine ne permet pas de reconnaître la présence de Tibétains. Ainsi, le Tibet est colonisé depuis des décennies par des Chinois en vue de lui faire perdre toute spécificité. D'autre part, Pékin s'est toujours défié des religions. Cela pouvait être à l'origine une conséquence de la doctrine marxiste, qui considérait la religion comme l'opium du peuple, mais aujourd'hui, il s'agit bien davantage du souci de ne pas laisser s'installer une autre influence que celle du pouvoir en place. Les religions sont donc placées sous la tutelle directe du gouvernement chinois, à l'exclusion de tout autre. Le parti communiste chinois nomme ainsi des évêques qui lui sont loyaux, et combat la hiérarchie nommée par le Vatican. A ce double titre, le Dalaï Lama est donc considéré comme un ennemi.
Si celui-ci est actuellement bien identifié, la Chine compte bien profiter d'un éventuel "passage de pouvoir" pour mettre définitivement sous tutelle le bouddhisme tibétain. Le but sera alors de reproduire la méthode employée pour le Panchen Lama, numéro deux dans la hiérarchie des lamas tibétains. Après la mort (troublante) du précédent Panchen Lama en 1989, la Chine comme le Dalaï Lama avaient lancé une procédure pour reconnaître sa nouvelle réincarnation. Quand le Dalaï Lama reconnut officiellement Gedhun Choekyi Nyima, jeune garçon de six ans, comme le nouveau Panchen Lama en 1995, celui-ci disparut quelques jours plus tard, et n'a plus jamais été revu. La Chine affirme le "protéger" en un endroit tenu secret (ce qui signifie qu'il est emprisonné depuis cette époque), et après avoir fait également disparaître le moine qui trouva ce garçon, s'est occupé de reconnaître (par tirage au sort entre trois candidats) son propre Panchen Lama, Gyancain Norbu, évidemment à sa solde. Et depuis le 1er septembre dernier, une nouvelle réglementation prévoit que chaque nouvelle réincarnation devra désormais être approuvée par le pouvoir chinois. En clair, après avoir créé un Panchen Lama fantoche, il s'agira de montrer un Dalaï Lama tout aussi factice, entièrement dévoué à la cause du gouvernement chinois, lorsque l'actuel, Tenzin Gyatso, viendra à disparaître.
Pendant que l'on s'émerveille du développement économique chinois, et que l'on profite de ses avantages concurrentiels (le faible prix de la main d'œuvre), la Chine continue de bafouer quotidiennement les libertés de son peuple. Evidemment, les pouvoirs publics des autres grandes puissances n'ont jamais rien osé affirmer une quelconque réprobation envers de mouvements, tels que cette réglementation contrôlant les forces supérieures de la réincarnation. Ce qui était encore plus désolant, c'est que la peur de peur de perdre des contrats empêchait également de simplement discuter avec le Dalaï Lama, peut être le dernier authentique. De toutes façons, ces contrats chinois si recherchés sont d'ores et déjà des pièges, où les dispositions obligatoires de joint ventures et de transferts de technologies sont si importantes qu'ils ne font que créer de redoutables concurrents. Du reste, les éventuelles vexations chinoises ne sont menaçantes que si cela l'incite à se tourner vers des pays plus conciliants et lâches. Pour bien faire, l'idéal serait donc que chaque grande puissance veille à inviter le Dalaï Lama en visite officielle. Stephen Harper, le Premier ministre canadien, vient d'ailleurs de le faire à la suite d'Angela Merkel. Ils ont bien raison, et il faut espérer que le mouvement s'étende à la France, et au reste de l'Union Européenne et des pays développés.
aucun commentaire
:: aucun trackback
vendredi 14 septembre 2007
Par xerbias,
vendredi 14 septembre 2007 à 12:21 :: Faits politiques

Depuis le début de l'année, la période est peu propice pour les vétérans de la vie politique française. C'est Michel Rocard qui est atteint d'un accident vasculaire cérébral, ce sont aussi les décès de Pierre Messmer et surtout celui de Raymond Barre qui montrent que toute une génération d'hommes politiques français est en train de s'en aller. Même ceux qui sont épargnés par les soucis de santé s'éloignent du premier plan. Edouard Balladur s'occupe désormais d'une commission sur les institutions, Jacques Chirac crée une fondation pour l'entente entre les peuples, mais ils n'ont plus aucune responsabilité exécutive ou législative. De toutes façons, même s'ils ne souhaitaient pas prendre leur retraite, ils sont poussés vers la porte de sortie. Ainsi, Lionel Jospin voulait être à nouveau candidat lors de la dernière présidentielle pour le Parti Socialiste, mais s'est retiré devant le faible accueil réservé à cette candidature par sa famille politique. Et même Michel Rocard a cru bon de proposer à Ségolène Royal qu'elle se retire en sa faveur lors de cette même présidentielle, ne se rendant pas compte des implications qu'aurait eu la candidature d'un homme de soixante-seize ans à la magistrature suprême. D'une manière générale, c'est donc l'ensemble des anciens qui est en train de s'en aller, les dernières élections ayant montrées que c'étaient maintenant les baby-boomers qui sont sollicités pour les plus hautes responsabilités, la génération actuellement en place étant née bien après la fin de la seconde guerre mondiale. Même Laurent Fabius, pourtant né en 1946, n'apparaît plus comme un renouvellement au vu du temps qu'il a passé sur la scène politique française.
La génération qui prend fin aura duré de la fin des années soixante jusqu'au début des années 2000, étant elle-même née entre les deux guerres. Sa grande légitimité n'est pourtant pas exceptionnelle, cette caractéristique est même plutôt courante dans la classe politique française. Après tout, Adolphe Thiers avait connu une carrière d'une quarantaine d'années, et celle de Georges Clemenceau s'étend sur une cinquantaine d'années. A ce titre, les quarante années qui séparent la première élection de Jacques Chirac au poste de député et la fin de son mandat de Président de la République sont moins surprenantes. Certaines personnalités de second plan continuent d'ailleurs de siéger à l'Assemblée Nationale, avec les députés Didier Julia et Jean Tibéri qui y ont été élus pour la première fois respectivement en 1967 et en 1968, et font partie de la nouvelle législature.
L'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération permet de fait un renouvellement du personnel politique, qui était tout de même nécessaire. Il serait d'ailleurs souhaitable que ce renouvellement se fasse de façon plus fréquente, petit à petit. D'une manière générale, l'un des dangers de la condition de professionnel de la politique est de se couper de ses concitoyens, et rester indéfiniment dans ce milieu n'aide pas à écarter ce danger. Il faudrait en fait trouver un équilibre entre expérience politique, nécessaire pour occuper les postes à hautes responsabilités, et lien avec la vie quotidienne de la population, ce qui ne passe pas forcément par un mandat local, pour ne pas s'enfermer dans les querelles intestines propres au microcosme. Les manœuvres politiques semblent pourtant être l'un des passages obligés d'une carrière dans ce milieu. L'expérience de Raymond Barre le montre : arrivé en politique sans l'avoir vraiment voulu, il s'était présenté à la présidentielle de 1988. Ce fût un échec. Depuis l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, tous ceux qui sont devenus Président de la République avait fait de leur élection une obsession. Il faut espérer que de telles ambitions servent de véritables convictions. Sans cela, vouloir le pouvoir pour le pouvoir, et rester à son poste par pur orgueil ne sert pas les Français qu'ils représentent. Dès lors, mieux vaut apporter régulièrement un peu de fraîcheur dans le milieu politique.
aucun commentaire
:: aucun trackback
mercredi 12 septembre 2007
Par xerbias,
mercredi 12 septembre 2007 à 22:56 :: Europe

La polémique sur le siège du Parlement Européen refait surface fréquemment. Les députés européens ne sont pas les derniers à s'y engager, ils rejettent en majorité le fait que le Parlement Européen soit séparé en deux, et doive être transféré en fonction des sessions. Le Parlement se réunit en séance plénière à Strasbourg, et en séances restreintes et en commissions à Bruxelles. Le coût de ces transferts réguliers est de 200 millions d'euros pour l'Union Européenne. Non seulement ces dépenses sont inutiles, mais le fait même que les députés européens doivent osciller entre deux de travail est absurde. Il est donc rare de trouver de véritables soutiens à cette division du Parlement Européen. Mais se pose alors la question de la ville qui doit tout regrouper. Les députés européens préfèrent Bruxelles, où ils ont leurs habitudes. En tant que capitale de la Belgique, la ville est très grande, dispose de tous les équipements, et en tant que siège de multiples autres institutions, est déjà largement polyglotte. Le fait que la Commission Européenne s'y trouve déjà peut être vu comme une façon de faciliter l'influence (réciproque) entre ces deux organes de l'Union Européenne. Mais l'on peut se demander si justement l'exécutif et le législatif de l'Union Européenne ont besoin d'être centralisés au même endroit.
Ce n'est de toutes façons pas les députés européens qui choisissent où ils siègent, puisque c'est décidé dans les Traités discutés entre les gouvernements. Historiquement, il y a trois capitales à l'Union Européenne : l'exécutif, c'est-à-dire la Commission Européenne est à Bruxelles, le législatif, soit le Parlement Européen, est à Strasbourg, et la capitale du Luxembourg est également l'un des sièges de l'Union, en abritant notamment la Cour de Justice des Communautés européennes. Le Luxembourg n'héberge pourtant pas la Cour Européenne des Droits de l'homme, qui est à Strasbourg, mais accueille néanmoins le secrétariat général du Parlement Européen, ainsi que certains services de la Commission Européenne. Un échange pourrait être fait, pour que Luxembourg puisse être le centre des institutions judiciaires de l'Union Européenne, et que Strasbourg regroupe tout ce qui constitue le Parlement Européen. La France refuse que la ville alsacienne voie partir le Parlement, alors qu'elle est aujourd'hui complètement consacrée au projet européen. Le fait qu'une des capitales de l'Union Européenne soit à Strasbourg est un symbole majeur en soit. Après tout, l'Europe s'est faite sur le refus de la guerre, d'abord via l'alliance entre l'Allemagne et la France. Et en moins d'un siècle, il y eut pas moins de trois guerres entre ces deux pays, portant (entre autres), sur la domination de l'Alsace et la Lorraine. Ces basculements ont fait de l'Alsace un territoire disposant d'une double culture, d'une grande ouverture et d'une forte sensibilisation sur les enjeux européens. Faire de cette ville une capitale européenne est un signal d'apaisement et d'ambition de développement commun.
Evidemment, Strasbourg a été longtemps mal desservi par les infrastructures. Il y a désormais le TGV Est, qui la relie plus rapidement à Paris, et qui pourra accélérer à terme également les liaisons avec Francfort ou Stuttgart. On peut néanmoins regretter l'absence d'une autre ligne à grande vitesse qui relierait Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, les trois capitales européennes. Pour qu'il n'y ait qu'une capitale européenne, il faudrait qu'elle semble peu attachée à l'un ou l'autre des pays de l'Union. Cela peut être le cas de Strasbourg. Mais cela pourrait également être le cas de Bruxelles, de façon surprenante, sur le long terme. En effet, en cas d'implosion de la Belgique, son actuelle capitale serait l'objet d'un conflit politique pour savoir quel serait alors son statut, alors qu'elle est actuellement l'une des trois parties de la Belgique, une ville neutre et censée être bilingue. Une solution pourrait être d'en faire une ville internationale, entièrement dévolue à l'Union Européenne. Mais une telle évolution ne relève que d'échéances très lointaines, en plus d'être loin d'être certaine. En attendant, si certaines institutions peuvent être déplacées, cela ne doit pas forcément être fait dans le but de sacrifier l'une des capitales de l'Union Européenne au profit d'une autre.
3 commentaires
:: aucun trackback
lundi 10 septembre 2007
Par xerbias,
lundi 10 septembre 2007 à 23:31 :: Pensée politique

Après ses dernières défaites, le Parti Socialiste est à nouveau en phase de rénovation. La principale question est de savoir s'il arrivera à régler le dilemme qu'il n'a pas voulu trancher ces cinq dernières années : doit-il rester fidèle au socialisme énoncé lors du congrès d'Epinay, ou bien doit-il assumer une ligne politique sociale démocrate ? A force de croire que les deux tendances pouvaient cohabiter, les socialistes se sont forcés à ne rien trancher et à ne pas avoir de vision claire des politiques à mettre en œuvre. La principale difficulté est de mettre un terme définitif à la doctrine marxiste, qui continue toujours de former les esprits d'un grand nombre de citoyens et de responsables politiques. Les habitudes sont ancrées de façon si profonde que leurs remises en cause ne semble pas aller de soi. Ainsi, François Hollande, lors de la dernière université d'été, annonce que "le Grand Soir, c'est fini" juste avant d'entonner l'Internationale avec le reste des participants à la réunion. D'une manière générale, la thématique de la lutte des classes continue de constituer le socle de pensée idéologique d'une large partie de la gauche, qui croit que le pouvoir d'achat s'accroît à travers la lutte sociale, qu'il y a toujours suffisamment d'argent pour exaucer tous les désirs, à condition de le prendre dans la poche du patron, et que ceux qui sont riches exploitent les pauvres travailleurs. Déjà fortement répandue en France, cette pensée est même dominante chez les syndicats, leur empêchant ainsi d'avoir un comportement crédible et responsable. Ainsi, le syndicat Sud Rail n'hésite pas actuellement à proclamer que plutôt que de faire revenir les régimes spéciaux de retraites au niveau de ceux du reste de la population, il faut que tout le monde redescende à 37 années et demi de cotisation, vu que, selon leur raisonnement, "la France produit suffisamment de richesse qu'il faut prendre là où elles sont".
La rhétorique marxiste continue donc de durer. Elle est certes séduisante : c'est le seul système politico-économique complet conçu comme alternative au capitalisme. Mais d'une part il a montré son inefficacité, d'autre part l'analyse de Karl Marx de la vie économique du XIXème siècle n'est plus de tout à fait de mise aujourd'hui. La "classe moyenne" est de nos jours celle qui domine largement les autres, et ce d'autant plus qu'il n'y pas de conscience de classe où que ce soit dans la société. De ce fait, la lutte des classes n'est pas possible. Et plutôt que de vouloir persévérer dans une vision conflictuelle des rapports sociaux, il vaudrait mieux privilégier une approche apaisée des négociations. Car de toutes façons, l'internationale des travailleurs est moins que jamais d'actualité, comme les entreprises sont en concurrence mondiale les unes avec les autres. La France est l'un des derniers pays à conserver une aussi forte dose de marxisme dans son approche des choses, et cela la dessert quotidiennement, ne serait-ce que pour faire les réformes structurelles nécessaires à sa remise en état. Il s'agit là d'un véritable conservatisme, de corporatismes tenaces qui immobilisent la société française et l'empêche d'avancer. Voilà pourquoi il faut arrêter de toujours considérer les choses sous l'angle des protestations sociales, car il est nécessaire de solder une bonne fois pour toutes la lutte des classes, d'en finir définitivement avec le marxisme.
Il est donc souhaitable que les syndicats représentent mieux une société qui a, pour une bonne part, reconnu l'inutilité des vieilles recettes qui promettaient le bonheur pour tous à condition de s'en prendre à celui qui réussit dans la vie. De même, le Parti Socialiste ne doit pas hésiter à rejeter franchement ceux qui, parmi ses membres, continuent de croire que tout ce qui est à leur droite représente le mal et souhaitent abolir le capitalisme. Des gens comme Jean-Luc Mélenchon et Henri Emmanuelli ne doivent plus être capables d'influencer la ligne politique de leur parti, quitte à ce qu'ils le quittent pour rejoindre le moribond Parti Communiste qui défend les mêmes positions qu'eux. Et c'est, au final, une prise de conscience généralisée qu'il faut souhaiter voir s'accomplir : la lutte des classes et la rhétorique marxiste sont des visions dépassées de la société, qu'elles n'ont jamais servie. Malheureusement, cela constitue désormais une partie de notre culture, cette idéologie pouvant même se retrouver facilement parmi les jeunes générations ou certaines catégories de salariés du secteur public. Ce n'est pas pour cela qu'il faille s'en contenter pour autant.
aucun commentaire
:: aucun trackback
samedi 8 septembre 2007
Par xerbias,
samedi 8 septembre 2007 à 13:07 :: Monde
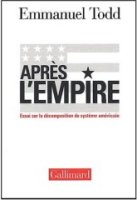
Il y a déjà cinq années, le démographe Emmanuel Todd publiait
Après l'empire, essai sur la décomposition du système américain. Sa thèse est plutôt simple : les Etats-Unis seraient sur le déclin, et cela expliquerait le comportement actuel de ce pays. Comme Emmanuel Todd avait, en 1976, prédit la fin de la puissance soviétique dans son livre La Chute finale
, nombreux furent ceux qui ont trouvé des raisons de croire à sa nouvelle prophétie. Pourtant, les raisons qui amèneraient ce déclin américain ne sont pas totalement convaincantes. En effet, sa démonstration repose avant tout sur une batterie d'indicateurs démographiques, tel que le taux de fécondité, ou bien sur l'évolution des modèles familiaux américains. En insistant si lourdement sur ces considérations, il donne surtout l'impression d'un démographe qui croit que le monde entier peut totalement s'expliquer par les évolutions démographiques, alors qu'elles ne sont qu'une force de changement parmi d'autres. Certes, il avance également d'autres arguments, tels que les déficits de la balance commerciale et de la balance des paiements des Etats-Unis. Ces déficits constituent réellement une menace pour l'économie, mais il serait réducteur que de croire qu'il s'agit d'une menace pour la seule économie américaine : si un jour les dollars sortants des Etats-Unis n'y étaient plus réinvestis, provoquant un effondrement de l'économie américaine, cela pénaliserait évidemment par ricochet l'ensemble de l'économie mondiale. Rien ne dit que d'autres entités, comme l'Europe ou la Chine, seraient capables d'assumer un rôle aussi central, ou même que le système économique actuel peut changer sans dégâts mondiaux.
En outre, la thèse d'Emmanuel Todd est pénalisée par une analyse géostratégique expliquant le comportement actuel des Etats-Unis par une fuite en avant, devant la perspective d'être de moins en moins puissante. Fondamentalement ce n'est certainement la peur d'être faible qui a poussé les Etats-Unis à intervenir militairement en Afghanistan et en Irak, mais bel et bien la certitude d'être fort. D'ailleurs, Emmanuel Todd néglige complètement, ou refuse de voir un élément fondamental de la puissance américaine : sa domination idéologique et culturelle. A l'heure où l'anti-américanisme est au plus haut à travers le monde, les Etats-Unis n'en reste pas moins au centre du monde culturel, et demeurent la cible des regards d'une énorme partie du monde. Que ce soit dans le domaine des films, de la littérature, de la musique, des études universitaires, du management d'entreprise ou de l'innovation technique, les Etats-Unis dépassent de loin les autres pays. Ne serait-ce qu'en France, pays pourtant très anti-américain, cette domination culturelle est plus que jamais visible. Mais cet aspect ne semble pas avoir attiré l'attention du démographe, alors que cette situation ne parait pas menacée.
Ce livre d'Emmanuel Todd a rencontré un grand succès principalement pour deux raisons : d'une part, sa prédiction réussie quant à l'URSS lui a donné une certaine crédibilité, dans le sens où l'on pourrait croire qu'il a trouvé la clé qui permet de prédire l'avenir. Pourtant, un succès ne garantit pas le suivant. Ainsi, à ceux qui doutaient de son concept révolutionnaire d'automobile, la Smart, le fondateur des montres Swatch, Nicolas Hayek, se bornait à répondre qu'on lui avait fait les mêmes observations lorsqu'il se lançait dans les montres. Pourtant, le succès de la Smart fut loin de celui qu'il escomptait. D'une manière générale, faire des prévisions à long terme sur l'avenir est un exercice plus que risqué, il est même illusoire que de croire que l'on puisse trouver une méthode efficace en la matière. Il suffit de voir la très longue liste de ceux qui s'y sont risqués, des personnalités parfois très illustres, et qui ont échoué. Certes, le nombre est si grand que statistiquement, parmi les théories lancées, l'une d'entre elle apparaît comme pas trop éloignée de ce qu'il se passe effectivement. Mais cela n'indique en rien de futurs succès.
Et en l'occurrence, si la thèse défendue par Emmanuel Todd paraît crédible à autant de lecteurs, et la deuxième raison du succès du livre, c'est qu'elle est la théorisation des espoirs fondés par tous ceux qui souhaitent un affaiblissement des Etats-Unis. L'ouvrage entier est en fait construit de telle manière que son auteur cherche des raisons pour justifier l'idée qu'il s'était fait avant de commencer son analyse : le déclin américain. Ne serait-ce que de qualifier, dès le titre, les Etats-Unis d'empire montre le présupposé qui est à l'œuvre. C'est ainsi surtout un fantasme que l'on découvre et qui est justifié a posteriori, le fantasme de la disparition de l'influence américaine, combattue parce que justement trop forte. Croire qu'elle est faible derrière les apparences revient en fin de compte à prendre ses désirs pour des réalités, et c'est bien pour cela que la démonstration tentée est si peu convaincante.
un commentaire
:: aucun trackback
jeudi 6 septembre 2007
Par xerbias,
jeudi 6 septembre 2007 à 15:47 :: General

Jean-Pierre Elkabbach, le président de la chaîne Public Sénat, a récemment déclaré qu'il avait demandé au CSA d'octroyer à sa chaîne une fréquence supplémentaire sur la TNT, pour que Public Sénat et LCP - Assemblée Nationale ait chacune leur canal de diffusion, et n'ait plus à cohabiter ensemble. En effet, actuellement les deux entités se partagent le temps d'antenne, en faisant alterner les programmes produits par l'une et l'autre. Jean-Pierre Elkabbach comme Michel Richard, le président de LCP - Assemblée Nationale, se targuent d'avoir d'ores et déjà des grilles de programmes de prêtes dans cette éventualité, chaque chaîne pouvant diffuser 24 heures sur 24 dès que des fréquences séparées leur seront accordées. Cela risque de prendre du temps, car pour que des fréquences de la TNT se libèrent, il faudrait que les ondes hertziennes ne soient plus occupées que par des chaînes diffusées numériquement. D'éventuels canaux supplémentaires pourront être libérés si les six chaînes principales actuelles arrêtent de diffuser en analogique hertzien, ce qui prendra bien plusieurs années, vu que c'est encore le principal moyen de réception de la télévision par les ménages français.
Mais outre le temps que cela prendra, il y a quelque chose d'incongru dans ces demandes. Quelle est la nécessité fondamentale pour que chaque chambre du parlement ait sa chaîne dédiée diffusant 24 heures sur 24, alors que les fréquences de la TNT sont limitées en nombre ? Jean-Pierre Elkabbach pointe le caractère "hégémonique" de LCP - Assemblée Nationale, et l'on comprend alors qu'il s'agit de rivalités entre chaînes, entre frères ennemis, ou même entre institutions qui se disputent l'éclairage médiatique. Cela montre alors la vanité de l'entreprise, où chacun se bat pour sa gloire sans se demander à quoi tout cela sert-il, et ce dans l'indifférence générale. Car ni l'une ni l'autre ne souscrit aux enquêtes de mesure d'audience, le but n'étant évidemment pas d'en faire. Il s'agit avant tout d'assurer un service public. Et lorsqu'une étude tente d'évaluer le nombre de téléspectateurs du canal commun aux deux chaînes, les résultats sont tellement catastrophiques que les deux présidents montent pour l'occasion au créneau pour affirmer à l'unisson que le canal est très regardé, sans en apporter une quelconque preuve. De plus, le coût des deux chaînes a avoisiné les 22 millions d'euros en 2006, une somme en hausse de plus de 65 % sur les cinq années précédentes. On se retrouve alors avec un nouveau puit de dépenses créé pour satisfaire les égos des responsables des deux chambres du parlement, pour que chaque institution ait sa propre chaîne qui parle d'eux en permanence.
Certes, il peut être souhaitable qu'il y ait une chaîne consacrée à la citoyenneté. Les débats de chaque chambre peuvent être diffusés simultanément sur internet, et un différé n'est pas un obstacle majeur pour une chaîne parlementaire qui serait diffusé sur des canaux engendrant de véritables coûts (tels que la diffusion par le satellite ou la TNT). Fondamentalement, rien n'empêche les débats du Sénat et de l'Assemblée Nationale d'alterner sur un même canal. En outre, il est ahurissant que l'enregistrement des débats de ces deux chambres soit pris en charge par deux entités différentes. LCP-AN et Public Sénat doivent fusionner, et non pas chercher à être toujours plus divisées. Les éventuels programmes supplémentaires produits par la chaîne parlementaire doivent autant chercher la qualité que l'économie, dans la mesure où il s'agit d'abord un coût pour les finances publiques. Il est alors inutile de persévérer dans la grille actuelle des programmes, où les vedettes mises à l'antenne sont nombreuses sans que cela change l'attractivité des deux chaînes. Evidemment, une fusion de deux chaînes qui entretiennent actuellement des relations difficiles risque d'être compliquée, mais c'est la moindre des choses à faire ne serait-ce que pour économiser au mieux les ressources de l'Etat, et aussi pour calmer les rêves d'auto-promotion de chaque assemblée qui ne les sert pas vraiment au bout du compte.
aucun commentaire
:: aucun trackback
mardi 4 septembre 2007
Par xerbias,
mardi 4 septembre 2007 à 14:59 :: Europe
A l'occasion d'une tournée de tous les pays d'Europe avant que la France ne prenne la présidence de l'Union Européenne, Nicolas Sarkozy va bientôt visiter la Hongrie. Il est assez rare que ce pays, pourtant membre de l'Union Européenne depuis trois ans, soit évoqué dans les médias français. La dernière fois, ce fut lorsque le Premier ministre hongrois avait avoué, dans un enregistrement rendu public à ses dépens, avoir menti à la population pendant son premier mandat et sa campagne de réélection, et n'avoir rien fait pour améliorer les finances publiques jusque là. La révélation avait provoqué des protestations d'une partie de l'opposition, alors que le Premier ministre refusait de démissionner (et reste d'ailleurs actuellement au pouvoir). Mais ces événements datent de pratiquement une année. D'une manière générale, cette faible couverture de l'actualité des pays de l'Europe de l'est est probablement le résultat d'un relatif éloignement géographique, ainsi que de la taille modeste de plusieurs de ces pays. La Hongrie a une population de dix millions de personnes, et est assez représentative de l'ensemble des pays de l'Europe centrale et orientale.
Ces pays différaient d'ailleurs peu de ceux de l'Europe de l'ouest à l'époque médiévale. Le royaume de Hongrie a vécu comme les autres jusqu'à la Renaissance, où il fut envahi par l'Empire Ottoman pendant un siècle et demi. A la suite de la victoire de l'Autriche contre les Ottomans, les Autrichiens ont profité de leur contre-offensive pour dominer la Hongrie, qui finit par devenir son égal au sein de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Dans cet ensemble, la Hongrie avait par elle-même des frontières très élargies par rapport à celles qu'elle connaît aujourd'hui, englobant des parties de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Yougoslavie. L'ensemble composite allait devenir la proie des nationalismes, aboutissant in fine à la première guerre mondiale. Le pays tient alors son rang dans le concert européen, bien que n'étant pas arrivé à un stade aussi avancé de la révolution industrielle que dans l'Europe de l'ouest. La Hongrie rentre ensuite dans les années trente dans la sphère d'influence des nazis, et à la suite de la seconde guerre mondiale, passe sous domination soviétique, qui lui impose un régime communiste.
Cette évolution est mal acceptée par le peuple qui n'était certainement pas demandeur. Les Hongrois arrivent en 1956 à desserrer l'étreinte stalinienne lors de l'insurrection de Budapest, qui bien qu'écrasée par l'Armée rouge, permet un assouplissement sur les dogmes communistes. Certes, le Parti Communiste est toujours le parti unique en contrôle des affaires, mais il y a alors une plus grande liberté d'agir et d'expression en Hongrie, ainsi qu'une meilleure efficacité économique, les biens de consommation étant plus privilégiés qu'en URSS. Il est d'ailleurs notable que parmi les pays du bloc soviétique, plus un gouvernement disposait d'autonomie par rapport à l'URSS, et plus les libertés de la population étaient fortes, et meilleur était le développement économique. C'est ainsi en Roumanie, où l'obscurantisme soviétique était le plus fort, que la pauvreté a été (et reste) la plus forte, tandis qu'en RDA, très autonome selon les standards des pays du Pacte de Varsovie, la satisfaction des besoins de la population était la plus grande. Il suffit ensuite de comparer l'énorme écart de développement entre la RFA et la RDA au moment de la réunification, alors qu'il s'agissait d'un seul pays avant la guerre, pour se rendre compte du gâchis réalisé par le communisme dans les pays de l'Europe centrale et orientale.
Evidemment, la transition à l'économie de marché est difficile au début des années 90. Mais ces pays connaissent un certain effet de rattrapage auquel la Hongrie ne fait pas exception. Ainsi, si l'économie hongroise est encore relativement éloignée de celles de ses voisins de l'Ouest, elle progresse quand même à un rythme satisfaisant. Ce qui est plus inquiétant, c'est le déficit important du budget public, atteignant chaque année 10 % environ du PIB. C'est bien éloigné des 3 % requis par le Traité de Maastricht pour se qualifier pour l'euro, et la Hongrie devra encore patienter pour adopter la monnaie unique, peut-être encore une demi-douzaine d'années. Elle n'est pas la seule : si la Slovénie et Malte se sont qualifiés pour une adoption en 2008, nombreux sont encore les pays de l'Europe de l'est qui peinent à atteindre les critères de Maastricht, ce qui retarde considérablement les échéances prévues initialement. En ce sens, la Hongrie est bien représentative des économies de l'Est de l'Europe. Mais ils n'ont bien sûr pas le monopole du souci du déficit public...
aucun commentaire
:: aucun trackback
dimanche 2 septembre 2007
Par xerbias,
dimanche 2 septembre 2007 à 11:05 :: Pensée politique

D'un point de vue idéologique, le regroupement et la disparition du RPR, d'une partie de l'UDF et de Démocratie Libérale de par la création de l'UMP n'ont pas été neutres. Le RPR était auparavant qualifié de parti gaulliste, un qualificatif que l'UMP n'a jamais eu, alors que François Bayrou essayait de se revendiquer comme le seul héritier du centrisme. De ce fait, en laissant cohabiter les idées, l'UMP n'a pas vraiment de socle idéologique naturel. Fondé pour soutenir la politique d'un Président de la République, Jacques Chirac, il a progressivement changé de braquet à mesure que le but devenait surtout de soutenir la candidature de celui qui deviendra le suivant, Nicolas Sarkozy. Celui-ci prend le contrôle de l'UMP à l'automne 2004 sans aucune difficulté. Depuis des mois il était évident qu'aucun autre candidat ne ferait le poids face à lui pour diriger la droite. En effet, avec son accession au ministère de l'Intérieur, il s'est forgé une popularité extrêmement forte auprès des Français, et encore plus pour ceux de droite pour qui il incarne un nouvel espoir. Nicolas Sarkozy était prêt à quitter le gouvernement pour prendre l'UMP car il savait qu'un grand parti politique acquis à sa cause serait nécessaire pour la campagne présidentielle. Sa candidature à l'investiture suprême, évidente, lui donne d'emblée une autorité sur la droite, et les thématiques qu'il déploie permettent de renouveler la pensée de ce mouvement.
Entré en politique pour défendre la candidature de Jacques Chaban-Delmas, Nicolas Sarkozy a probablement dès le départ voulu agir pour sa propre ascension et son propre succès. D'abord élevé dans le champ du gaullisme interprété par Jacques Chirac, il se montre par la suite attiré par les idées libérales. Le fait qu'il devienne balladurien en 1993 tient sans doute de cette conjonction de facteur : la possibilité de concilier le gaullisme du RPR, le libéralisme d'Edouard Balladur, et la satisfaction de son ambition, le Premier ministre de l'époque étant alors le grand favori de la présidentielle de 1995. Le plus balladurien des balladuriens, Nicolas Sarkozy est rejeté par son propre camp lors de la défaite de son mentor, et même aujourd'hui, ses relations avec Jacques Chirac restent ambiguës. Il revient dans le jeu après la dissolution, à la faveur d'une alliance avec Philippe Séguin pour prendre le RPR, puis mène la campagne des européennes de 1999, où il ne parle quasiment pas d'Europe, et où il échoue. Il arrive néanmoins à se rendre suffisamment incontournable pour qu'en 2002, Jacques Chirac accepte de le nommer numéro deux du gouvernement. A l'Intérieur, l'application des promesses de campagne du Président sur une approche sévère de la criminalité lui apporte enfin la popularité. Surtout, son discours politique, qui est d'assumer le fait d'être de droite plutôt que de s'en excuser, le rend audible auprès de toute une partie d'une population.
Si, dans les faits, il n'est pas si libéral qu'on le croit, c'est qu'il ne se prive pas d'être pragmatique, tout en gardant un discours clair et ambitieux pour la France. Et à vrai dire, son positionnement idéologique a beau être assez équilibré et inhabituel, ce qui le différencie surtout, c'est sa façon de faire. Pendant les cinq dernières années, pendant la campagne et pendant sa présidence, c'est une démarche volontariste qu'il applique. Son plus grand atout réside dans sa croyance que la politique ne doit pas se considérer comme vaincue d'avance par la force des choses, et qu'elle peut amener de grands résultats. Montrant le même activisme que Jacques Chirac dans sa jeunesse, il n'entend pas se retirer dans une posture prudente comme l'avait fait son aîné. Son énergie revendiquée doit lui permettre de changer la France, comme il considère que ses seuls efforts l'ont permis de monter au plus haut poste.
Lorsque l'on lit la biographie qu'a fait Max Gallo sur Napoléon Bonaparte, la comparaison vient facilement à l'esprit. Tous deux ont utilisé le même type d'énergie, d'abord pour monter les échelons, construire leur renommé par le mérite, prendre le pouvoir et imprimer leur marque sur la société. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que Max Gallo ait soutenu Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Evidemment, l'idée de ravoir un Napoléon pour diriger la France ne plait pas à tout le monde, les conséquences pouvant être graves. Mais au moins celui-ci évolue de manière quand même plus apaisé, dans un cadre de droit. Cela montre surtout ce qui a fait la force de Nicolas Sarkozy : son volontarisme, le fait d'apparaître comme un recours, une énergie sur laquelle on devrait pouvoir compter pour changer les choses. Car pour celui qui est ambitieux, l'ambition ultime est de réussir dans la tâche qui a été si longtemps attendue.
Image : The Economist
aucun commentaire
:: aucun trackback
 C'est à peu près le but de tous les ministres de la culture qui se sont succédés : démocratiser la culture, pour que se résorbe une partie du déficit en capital culturel qu'a une grande partie de la population vis-à-vis de la population. Actuellement, la principale mesure à l'étude pour y arriver serait d'instituer la gratuité des musées. Une telle mesure serait évidemment coûteuse, et de surcroît elle ne serait peut-être pas justifiée. En effet, pour les plus grands musées français, les rentrées financières représentées par la vente de billet permettent non seulement l'entretien de ces musées, mais aussi le financement d'autres musées ou monuments non rentables à eux seuls. De plus, ces lieux attirent de nombreux touristes étrangers, qui représentent avant tout une source d'argent pour la France, plutôt qu'un public à qui il faudrait faciliter l'accès à la culture. Surtout, les musées ont d'ores et déjà une grande panoplie de réductions en tous genres pour rendre peu coûteux la visite au public. De nombreux musées, comme le Louvre ou le musée d'Orsay, sont déjà totalement gratuits le premier dimanche du mois, et le Château de Versailles, qui est également un lieu de culture, est gratuit pour tous les mineurs. Christine Albanel, l'actuelle ministre de la culture, doit bien le savoir, puisqu'elle était présidente de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles avant d'entrer dans le gouvernement. Forte de cette expérience, elle a choisi une voie sage en ne faisant qu'expérimenter cette gratuité pendant un semestre dans des musées de petite taille, qui attirent avant tout un public local.
C'est à peu près le but de tous les ministres de la culture qui se sont succédés : démocratiser la culture, pour que se résorbe une partie du déficit en capital culturel qu'a une grande partie de la population vis-à-vis de la population. Actuellement, la principale mesure à l'étude pour y arriver serait d'instituer la gratuité des musées. Une telle mesure serait évidemment coûteuse, et de surcroît elle ne serait peut-être pas justifiée. En effet, pour les plus grands musées français, les rentrées financières représentées par la vente de billet permettent non seulement l'entretien de ces musées, mais aussi le financement d'autres musées ou monuments non rentables à eux seuls. De plus, ces lieux attirent de nombreux touristes étrangers, qui représentent avant tout une source d'argent pour la France, plutôt qu'un public à qui il faudrait faciliter l'accès à la culture. Surtout, les musées ont d'ores et déjà une grande panoplie de réductions en tous genres pour rendre peu coûteux la visite au public. De nombreux musées, comme le Louvre ou le musée d'Orsay, sont déjà totalement gratuits le premier dimanche du mois, et le Château de Versailles, qui est également un lieu de culture, est gratuit pour tous les mineurs. Christine Albanel, l'actuelle ministre de la culture, doit bien le savoir, puisqu'elle était présidente de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles avant d'entrer dans le gouvernement. Forte de cette expérience, elle a choisi une voie sage en ne faisant qu'expérimenter cette gratuité pendant un semestre dans des musées de petite taille, qui attirent avant tout un public local.  En 1994 le déficit du budget de l'Etat canadien atteignait un montant représentant 5,3 % du PIB, et la dette publique dépassait largement les 60 % du PIB. Elu avec un mandat fort en matière d'assainissement des finances publiques, le Premier ministre Jean Chrétien s'est efforcé de rétablir l'équilibre budgétaire via un effort colossal en matière de réduction des dépenses publiques. Et avec succès, puisque quelques années plus tard l'Etat canadien retrouvait un excédent budgétaire, et dès 1995 le montant de la dette a commencé à diminuer en proportion du PIB. Depuis 1998, le budget canadien est excédentaire, et en 2005 la dette publique représentait moins de 40 % du PIB. Une remise en état aussi spectaculaire fait évidemment envie aux responsables français, et certaines personnalités politiques ont fait le voyage au Canada pour y prendre des leçons en matière de réforme de l'Etat.
En 1994 le déficit du budget de l'Etat canadien atteignait un montant représentant 5,3 % du PIB, et la dette publique dépassait largement les 60 % du PIB. Elu avec un mandat fort en matière d'assainissement des finances publiques, le Premier ministre Jean Chrétien s'est efforcé de rétablir l'équilibre budgétaire via un effort colossal en matière de réduction des dépenses publiques. Et avec succès, puisque quelques années plus tard l'Etat canadien retrouvait un excédent budgétaire, et dès 1995 le montant de la dette a commencé à diminuer en proportion du PIB. Depuis 1998, le budget canadien est excédentaire, et en 2005 la dette publique représentait moins de 40 % du PIB. Une remise en état aussi spectaculaire fait évidemment envie aux responsables français, et certaines personnalités politiques ont fait le voyage au Canada pour y prendre des leçons en matière de réforme de l'Etat.  La séparation des pouvoirs distingue nettement le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Elle permet d'éviter une dangereuse concentration des pouvoirs dans les mains d'une seule personne, et donc protège le peuple du totalitarisme. Mais ces derniers temps, de nombreuses polémiques éclatent, où le pouvoir judiciaire reproche à l'exécutif de tenter d'interférer dans son fonctionnement, et de ne pas respecter de fait cette séparation. Le torchon brûlait déjà entre les magistrats et Nicolas Sarkozy, lorsque celui-ci était ministre de l'Intérieur. Depuis que ce dernier est devenu Président de la République, et donc Président de la République, les mêmes récriminations perdurent, surtout depuis que Rachida Dati est devenue ministre de la Justice en voulant appliquer la volonté présidentielle. Il faut dire que les syndicats de magistrats ont des avis sur tout ce qui touche la justice française : après avoir vaillamment défendu le juge Burgaud lorsqu'il s'est avéré que celui-ci avait mené une instruction exclusivement à charge dans l'affaire d'Outreau, ils ont combattu la plupart des lois demandées par Nicolas Sarkozy pour combattre l'insécurité, et contestent farouchement le fait que l'on puisse ne pas être d'accord avec une décision de justice. Ainsi, chaque remarque faite par un membre du Parlement ou un ministre sur les décisions rendues par les tribunaux est considérée comme une tentative d'influencer le système judiciaire français, et donc de ne pas respecter la séparation des pouvoirs. En même temps, la loi de la peine plancher sur les multi-récidives est combattue dans la mesure où les juges ont moins de latitude pour fixer la peine, certains juges préfèrent même ne pas reconnaître consciemment certains faits pourtant avérés pour ne pas voir cette nouvelle loi s'appliquer, et lorsqu'un procureur exprime sa volonté de ne pas appliquer la loi, les syndicats de magistrats s'émeuvent que l'on puisse considérer cela comme anormal.
La séparation des pouvoirs distingue nettement le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Elle permet d'éviter une dangereuse concentration des pouvoirs dans les mains d'une seule personne, et donc protège le peuple du totalitarisme. Mais ces derniers temps, de nombreuses polémiques éclatent, où le pouvoir judiciaire reproche à l'exécutif de tenter d'interférer dans son fonctionnement, et de ne pas respecter de fait cette séparation. Le torchon brûlait déjà entre les magistrats et Nicolas Sarkozy, lorsque celui-ci était ministre de l'Intérieur. Depuis que ce dernier est devenu Président de la République, et donc Président de la République, les mêmes récriminations perdurent, surtout depuis que Rachida Dati est devenue ministre de la Justice en voulant appliquer la volonté présidentielle. Il faut dire que les syndicats de magistrats ont des avis sur tout ce qui touche la justice française : après avoir vaillamment défendu le juge Burgaud lorsqu'il s'est avéré que celui-ci avait mené une instruction exclusivement à charge dans l'affaire d'Outreau, ils ont combattu la plupart des lois demandées par Nicolas Sarkozy pour combattre l'insécurité, et contestent farouchement le fait que l'on puisse ne pas être d'accord avec une décision de justice. Ainsi, chaque remarque faite par un membre du Parlement ou un ministre sur les décisions rendues par les tribunaux est considérée comme une tentative d'influencer le système judiciaire français, et donc de ne pas respecter la séparation des pouvoirs. En même temps, la loi de la peine plancher sur les multi-récidives est combattue dans la mesure où les juges ont moins de latitude pour fixer la peine, certains juges préfèrent même ne pas reconnaître consciemment certains faits pourtant avérés pour ne pas voir cette nouvelle loi s'appliquer, et lorsqu'un procureur exprime sa volonté de ne pas appliquer la loi, les syndicats de magistrats s'émeuvent que l'on puisse considérer cela comme anormal.  De nos jours, le mot est lancé facilement, comme une insulte. Est poujadiste celui qui trouve qu'il y a trop de fonctionnaires et le niveau d'imposition trop élevé. A l'origine, le mot vient de Pierre Poujade, un libraire qui se lança en 1953 dans une croisade contre la fiscalité, et qui fut rapidement rejoint par de nombreux autres petits commerçants. Le mouvement, d'abord syndical, devint ensuite politique, et remporta un succès surprenant aux élections législatives de 1956, en réunissant plus de 11 % des suffrages, ce qui fit élire 52 députés sous les couleurs de l'Union et fraternité française, et en premier lieu Pierre Poujade lui-même. Ce mouvement avait sans conteste bénéficié des errements de la IVème République, de la médiocrité des gouvernements qui se succédaient rapidement, tant et si bien que le slogan "sortez les sortants" suffisait à fédérer la colère contre la classe politique en place. Il faut d'ailleurs noter que ce succès électoral fut très limité dans le temps, le mouvement de Pierre Poujade ne retrouvant pas les faveurs de l'électorat lorsque celui constatera à partir de 1958 qu'il y a à nouveau un capitaine sur le bateau, en la personne du Général de Gaulle.
De nos jours, le mot est lancé facilement, comme une insulte. Est poujadiste celui qui trouve qu'il y a trop de fonctionnaires et le niveau d'imposition trop élevé. A l'origine, le mot vient de Pierre Poujade, un libraire qui se lança en 1953 dans une croisade contre la fiscalité, et qui fut rapidement rejoint par de nombreux autres petits commerçants. Le mouvement, d'abord syndical, devint ensuite politique, et remporta un succès surprenant aux élections législatives de 1956, en réunissant plus de 11 % des suffrages, ce qui fit élire 52 députés sous les couleurs de l'Union et fraternité française, et en premier lieu Pierre Poujade lui-même. Ce mouvement avait sans conteste bénéficié des errements de la IVème République, de la médiocrité des gouvernements qui se succédaient rapidement, tant et si bien que le slogan "sortez les sortants" suffisait à fédérer la colère contre la classe politique en place. Il faut d'ailleurs noter que ce succès électoral fut très limité dans le temps, le mouvement de Pierre Poujade ne retrouvant pas les faveurs de l'électorat lorsque celui constatera à partir de 1958 qu'il y a à nouveau un capitaine sur le bateau, en la personne du Général de Gaulle.  La chancelière allemande Angela Merkel a décidé de rencontrer le Dalaï Lama, dirigeant en exil du Tibet, et autorité de la religion bouddhique récompensée du prix Nobel de la paix. Evidemment, cette démarche provoque la fureur du gouvernement chinois, qui voit dans ce moine pacifiste un agent séparationniste, alors que celui-ci ne prône même pas l'indépendance de son pays pourtant militairement conquis il y a plus de cinquante ans, mais seulement l'autonomie. La Chine, qui considère le Tibet comme l'une de ses provinces, n'entend pas que le Tibet ait un quelconque régime spécial. D'une part, la nature nationaliste du pouvoir en place en Chine ne permet pas de reconnaître la présence de Tibétains. Ainsi, le Tibet est colonisé depuis des décennies par des Chinois en vue de lui faire perdre toute spécificité. D'autre part, Pékin s'est toujours défié des religions. Cela pouvait être à l'origine une conséquence de la doctrine marxiste, qui considérait la religion comme l'opium du peuple, mais aujourd'hui, il s'agit bien davantage du souci de ne pas laisser s'installer une autre influence que celle du pouvoir en place. Les religions sont donc placées sous la tutelle directe du gouvernement chinois, à l'exclusion de tout autre. Le parti communiste chinois nomme ainsi des évêques qui lui sont loyaux, et combat la hiérarchie nommée par le Vatican. A ce double titre, le Dalaï Lama est donc considéré comme un ennemi.
La chancelière allemande Angela Merkel a décidé de rencontrer le Dalaï Lama, dirigeant en exil du Tibet, et autorité de la religion bouddhique récompensée du prix Nobel de la paix. Evidemment, cette démarche provoque la fureur du gouvernement chinois, qui voit dans ce moine pacifiste un agent séparationniste, alors que celui-ci ne prône même pas l'indépendance de son pays pourtant militairement conquis il y a plus de cinquante ans, mais seulement l'autonomie. La Chine, qui considère le Tibet comme l'une de ses provinces, n'entend pas que le Tibet ait un quelconque régime spécial. D'une part, la nature nationaliste du pouvoir en place en Chine ne permet pas de reconnaître la présence de Tibétains. Ainsi, le Tibet est colonisé depuis des décennies par des Chinois en vue de lui faire perdre toute spécificité. D'autre part, Pékin s'est toujours défié des religions. Cela pouvait être à l'origine une conséquence de la doctrine marxiste, qui considérait la religion comme l'opium du peuple, mais aujourd'hui, il s'agit bien davantage du souci de ne pas laisser s'installer une autre influence que celle du pouvoir en place. Les religions sont donc placées sous la tutelle directe du gouvernement chinois, à l'exclusion de tout autre. Le parti communiste chinois nomme ainsi des évêques qui lui sont loyaux, et combat la hiérarchie nommée par le Vatican. A ce double titre, le Dalaï Lama est donc considéré comme un ennemi.  Depuis le début de l'année, la période est peu propice pour les vétérans de la vie politique française. C'est Michel Rocard qui est atteint d'un accident vasculaire cérébral, ce sont aussi les décès de Pierre Messmer et surtout celui de Raymond Barre qui montrent que toute une génération d'hommes politiques français est en train de s'en aller. Même ceux qui sont épargnés par les soucis de santé s'éloignent du premier plan. Edouard Balladur s'occupe désormais d'une commission sur les institutions, Jacques Chirac crée une fondation pour l'entente entre les peuples, mais ils n'ont plus aucune responsabilité exécutive ou législative. De toutes façons, même s'ils ne souhaitaient pas prendre leur retraite, ils sont poussés vers la porte de sortie. Ainsi, Lionel Jospin voulait être à nouveau candidat lors de la dernière présidentielle pour le Parti Socialiste, mais s'est retiré devant le faible accueil réservé à cette candidature par sa famille politique. Et même Michel Rocard a cru bon de proposer à Ségolène Royal qu'elle se retire en sa faveur lors de cette même présidentielle, ne se rendant pas compte des implications qu'aurait eu la candidature d'un homme de soixante-seize ans à la magistrature suprême. D'une manière générale, c'est donc l'ensemble des anciens qui est en train de s'en aller, les dernières élections ayant montrées que c'étaient maintenant les baby-boomers qui sont sollicités pour les plus hautes responsabilités, la génération actuellement en place étant née bien après la fin de la seconde guerre mondiale. Même Laurent Fabius, pourtant né en 1946, n'apparaît plus comme un renouvellement au vu du temps qu'il a passé sur la scène politique française.
Depuis le début de l'année, la période est peu propice pour les vétérans de la vie politique française. C'est Michel Rocard qui est atteint d'un accident vasculaire cérébral, ce sont aussi les décès de Pierre Messmer et surtout celui de Raymond Barre qui montrent que toute une génération d'hommes politiques français est en train de s'en aller. Même ceux qui sont épargnés par les soucis de santé s'éloignent du premier plan. Edouard Balladur s'occupe désormais d'une commission sur les institutions, Jacques Chirac crée une fondation pour l'entente entre les peuples, mais ils n'ont plus aucune responsabilité exécutive ou législative. De toutes façons, même s'ils ne souhaitaient pas prendre leur retraite, ils sont poussés vers la porte de sortie. Ainsi, Lionel Jospin voulait être à nouveau candidat lors de la dernière présidentielle pour le Parti Socialiste, mais s'est retiré devant le faible accueil réservé à cette candidature par sa famille politique. Et même Michel Rocard a cru bon de proposer à Ségolène Royal qu'elle se retire en sa faveur lors de cette même présidentielle, ne se rendant pas compte des implications qu'aurait eu la candidature d'un homme de soixante-seize ans à la magistrature suprême. D'une manière générale, c'est donc l'ensemble des anciens qui est en train de s'en aller, les dernières élections ayant montrées que c'étaient maintenant les baby-boomers qui sont sollicités pour les plus hautes responsabilités, la génération actuellement en place étant née bien après la fin de la seconde guerre mondiale. Même Laurent Fabius, pourtant né en 1946, n'apparaît plus comme un renouvellement au vu du temps qu'il a passé sur la scène politique française.  La polémique sur le siège du Parlement Européen refait surface fréquemment. Les députés européens ne sont pas les derniers à s'y engager, ils rejettent en majorité le fait que le Parlement Européen soit séparé en deux, et doive être transféré en fonction des sessions. Le Parlement se réunit en séance plénière à Strasbourg, et en séances restreintes et en commissions à Bruxelles. Le coût de ces transferts réguliers est de 200 millions d'euros pour l'Union Européenne. Non seulement ces dépenses sont inutiles, mais le fait même que les députés européens doivent osciller entre deux de travail est absurde. Il est donc rare de trouver de véritables soutiens à cette division du Parlement Européen. Mais se pose alors la question de la ville qui doit tout regrouper. Les députés européens préfèrent Bruxelles, où ils ont leurs habitudes. En tant que capitale de la Belgique, la ville est très grande, dispose de tous les équipements, et en tant que siège de multiples autres institutions, est déjà largement polyglotte. Le fait que la Commission Européenne s'y trouve déjà peut être vu comme une façon de faciliter l'influence (réciproque) entre ces deux organes de l'Union Européenne. Mais l'on peut se demander si justement l'exécutif et le législatif de l'Union Européenne ont besoin d'être centralisés au même endroit.
La polémique sur le siège du Parlement Européen refait surface fréquemment. Les députés européens ne sont pas les derniers à s'y engager, ils rejettent en majorité le fait que le Parlement Européen soit séparé en deux, et doive être transféré en fonction des sessions. Le Parlement se réunit en séance plénière à Strasbourg, et en séances restreintes et en commissions à Bruxelles. Le coût de ces transferts réguliers est de 200 millions d'euros pour l'Union Européenne. Non seulement ces dépenses sont inutiles, mais le fait même que les députés européens doivent osciller entre deux de travail est absurde. Il est donc rare de trouver de véritables soutiens à cette division du Parlement Européen. Mais se pose alors la question de la ville qui doit tout regrouper. Les députés européens préfèrent Bruxelles, où ils ont leurs habitudes. En tant que capitale de la Belgique, la ville est très grande, dispose de tous les équipements, et en tant que siège de multiples autres institutions, est déjà largement polyglotte. Le fait que la Commission Européenne s'y trouve déjà peut être vu comme une façon de faciliter l'influence (réciproque) entre ces deux organes de l'Union Européenne. Mais l'on peut se demander si justement l'exécutif et le législatif de l'Union Européenne ont besoin d'être centralisés au même endroit.  Après ses dernières défaites, le Parti Socialiste est à nouveau en phase de rénovation. La principale question est de savoir s'il arrivera à régler le dilemme qu'il n'a pas voulu trancher ces cinq dernières années : doit-il rester fidèle au socialisme énoncé lors du congrès d'Epinay, ou bien doit-il assumer une ligne politique sociale démocrate ? A force de croire que les deux tendances pouvaient cohabiter, les socialistes se sont forcés à ne rien trancher et à ne pas avoir de vision claire des politiques à mettre en œuvre. La principale difficulté est de mettre un terme définitif à la doctrine marxiste, qui continue toujours de former les esprits d'un grand nombre de citoyens et de responsables politiques. Les habitudes sont ancrées de façon si profonde que leurs remises en cause ne semble pas aller de soi. Ainsi, François Hollande, lors de la dernière université d'été, annonce que "le Grand Soir, c'est fini" juste avant d'entonner l'Internationale avec le reste des participants à la réunion. D'une manière générale, la thématique de la lutte des classes continue de constituer le socle de pensée idéologique d'une large partie de la gauche, qui croit que le pouvoir d'achat s'accroît à travers la lutte sociale, qu'il y a toujours suffisamment d'argent pour exaucer tous les désirs, à condition de le prendre dans la poche du patron, et que ceux qui sont riches exploitent les pauvres travailleurs. Déjà fortement répandue en France, cette pensée est même dominante chez les syndicats, leur empêchant ainsi d'avoir un comportement crédible et responsable. Ainsi, le syndicat Sud Rail n'hésite pas actuellement à proclamer que plutôt que de faire revenir les régimes spéciaux de retraites au niveau de ceux du reste de la population, il faut que tout le monde redescende à 37 années et demi de cotisation, vu que, selon leur raisonnement, "la France produit suffisamment de richesse qu'il faut prendre là où elles sont".
Après ses dernières défaites, le Parti Socialiste est à nouveau en phase de rénovation. La principale question est de savoir s'il arrivera à régler le dilemme qu'il n'a pas voulu trancher ces cinq dernières années : doit-il rester fidèle au socialisme énoncé lors du congrès d'Epinay, ou bien doit-il assumer une ligne politique sociale démocrate ? A force de croire que les deux tendances pouvaient cohabiter, les socialistes se sont forcés à ne rien trancher et à ne pas avoir de vision claire des politiques à mettre en œuvre. La principale difficulté est de mettre un terme définitif à la doctrine marxiste, qui continue toujours de former les esprits d'un grand nombre de citoyens et de responsables politiques. Les habitudes sont ancrées de façon si profonde que leurs remises en cause ne semble pas aller de soi. Ainsi, François Hollande, lors de la dernière université d'été, annonce que "le Grand Soir, c'est fini" juste avant d'entonner l'Internationale avec le reste des participants à la réunion. D'une manière générale, la thématique de la lutte des classes continue de constituer le socle de pensée idéologique d'une large partie de la gauche, qui croit que le pouvoir d'achat s'accroît à travers la lutte sociale, qu'il y a toujours suffisamment d'argent pour exaucer tous les désirs, à condition de le prendre dans la poche du patron, et que ceux qui sont riches exploitent les pauvres travailleurs. Déjà fortement répandue en France, cette pensée est même dominante chez les syndicats, leur empêchant ainsi d'avoir un comportement crédible et responsable. Ainsi, le syndicat Sud Rail n'hésite pas actuellement à proclamer que plutôt que de faire revenir les régimes spéciaux de retraites au niveau de ceux du reste de la population, il faut que tout le monde redescende à 37 années et demi de cotisation, vu que, selon leur raisonnement, "la France produit suffisamment de richesse qu'il faut prendre là où elles sont". 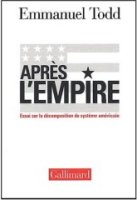 Il y a déjà cinq années, le démographe Emmanuel Todd publiait Après l'empire, essai sur la décomposition du système américain. Sa thèse est plutôt simple : les Etats-Unis seraient sur le déclin, et cela expliquerait le comportement actuel de ce pays. Comme Emmanuel Todd avait, en 1976, prédit la fin de la puissance soviétique dans son livre La Chute finale
Il y a déjà cinq années, le démographe Emmanuel Todd publiait Après l'empire, essai sur la décomposition du système américain. Sa thèse est plutôt simple : les Etats-Unis seraient sur le déclin, et cela expliquerait le comportement actuel de ce pays. Comme Emmanuel Todd avait, en 1976, prédit la fin de la puissance soviétique dans son livre La Chute finale Jean-Pierre Elkabbach, le président de la chaîne Public Sénat, a récemment déclaré qu'il avait demandé au CSA d'octroyer à sa chaîne une fréquence supplémentaire sur la TNT, pour que Public Sénat et LCP - Assemblée Nationale ait chacune leur canal de diffusion, et n'ait plus à cohabiter ensemble. En effet, actuellement les deux entités se partagent le temps d'antenne, en faisant alterner les programmes produits par l'une et l'autre. Jean-Pierre Elkabbach comme Michel Richard, le président de LCP - Assemblée Nationale, se targuent d'avoir d'ores et déjà des grilles de programmes de prêtes dans cette éventualité, chaque chaîne pouvant diffuser 24 heures sur 24 dès que des fréquences séparées leur seront accordées. Cela risque de prendre du temps, car pour que des fréquences de la TNT se libèrent, il faudrait que les ondes hertziennes ne soient plus occupées que par des chaînes diffusées numériquement. D'éventuels canaux supplémentaires pourront être libérés si les six chaînes principales actuelles arrêtent de diffuser en analogique hertzien, ce qui prendra bien plusieurs années, vu que c'est encore le principal moyen de réception de la télévision par les ménages français.
Jean-Pierre Elkabbach, le président de la chaîne Public Sénat, a récemment déclaré qu'il avait demandé au CSA d'octroyer à sa chaîne une fréquence supplémentaire sur la TNT, pour que Public Sénat et LCP - Assemblée Nationale ait chacune leur canal de diffusion, et n'ait plus à cohabiter ensemble. En effet, actuellement les deux entités se partagent le temps d'antenne, en faisant alterner les programmes produits par l'une et l'autre. Jean-Pierre Elkabbach comme Michel Richard, le président de LCP - Assemblée Nationale, se targuent d'avoir d'ores et déjà des grilles de programmes de prêtes dans cette éventualité, chaque chaîne pouvant diffuser 24 heures sur 24 dès que des fréquences séparées leur seront accordées. Cela risque de prendre du temps, car pour que des fréquences de la TNT se libèrent, il faudrait que les ondes hertziennes ne soient plus occupées que par des chaînes diffusées numériquement. D'éventuels canaux supplémentaires pourront être libérés si les six chaînes principales actuelles arrêtent de diffuser en analogique hertzien, ce qui prendra bien plusieurs années, vu que c'est encore le principal moyen de réception de la télévision par les ménages français.  D'un point de vue idéologique, le regroupement et la disparition du RPR, d'une partie de l'UDF et de Démocratie Libérale de par la création de l'UMP n'ont pas été neutres. Le RPR était auparavant qualifié de parti gaulliste, un qualificatif que l'UMP n'a jamais eu, alors que François Bayrou essayait de se revendiquer comme le seul héritier du centrisme. De ce fait, en laissant cohabiter les idées, l'UMP n'a pas vraiment de socle idéologique naturel. Fondé pour soutenir la politique d'un Président de la République, Jacques Chirac, il a progressivement changé de braquet à mesure que le but devenait surtout de soutenir la candidature de celui qui deviendra le suivant, Nicolas Sarkozy. Celui-ci prend le contrôle de l'UMP à l'automne 2004 sans aucune difficulté. Depuis des mois il était évident qu'aucun autre candidat ne ferait le poids face à lui pour diriger la droite. En effet, avec son accession au ministère de l'Intérieur, il s'est forgé une popularité extrêmement forte auprès des Français, et encore plus pour ceux de droite pour qui il incarne un nouvel espoir. Nicolas Sarkozy était prêt à quitter le gouvernement pour prendre l'UMP car il savait qu'un grand parti politique acquis à sa cause serait nécessaire pour la campagne présidentielle. Sa candidature à l'investiture suprême, évidente, lui donne d'emblée une autorité sur la droite, et les thématiques qu'il déploie permettent de renouveler la pensée de ce mouvement.
D'un point de vue idéologique, le regroupement et la disparition du RPR, d'une partie de l'UDF et de Démocratie Libérale de par la création de l'UMP n'ont pas été neutres. Le RPR était auparavant qualifié de parti gaulliste, un qualificatif que l'UMP n'a jamais eu, alors que François Bayrou essayait de se revendiquer comme le seul héritier du centrisme. De ce fait, en laissant cohabiter les idées, l'UMP n'a pas vraiment de socle idéologique naturel. Fondé pour soutenir la politique d'un Président de la République, Jacques Chirac, il a progressivement changé de braquet à mesure que le but devenait surtout de soutenir la candidature de celui qui deviendra le suivant, Nicolas Sarkozy. Celui-ci prend le contrôle de l'UMP à l'automne 2004 sans aucune difficulté. Depuis des mois il était évident qu'aucun autre candidat ne ferait le poids face à lui pour diriger la droite. En effet, avec son accession au ministère de l'Intérieur, il s'est forgé une popularité extrêmement forte auprès des Français, et encore plus pour ceux de droite pour qui il incarne un nouvel espoir. Nicolas Sarkozy était prêt à quitter le gouvernement pour prendre l'UMP car il savait qu'un grand parti politique acquis à sa cause serait nécessaire pour la campagne présidentielle. Sa candidature à l'investiture suprême, évidente, lui donne d'emblée une autorité sur la droite, et les thématiques qu'il déploie permettent de renouveler la pensée de ce mouvement.